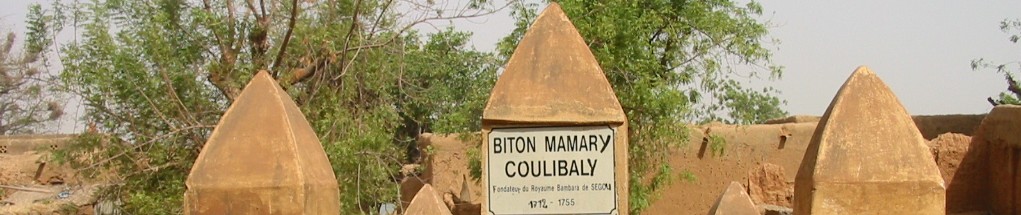Le premier établissement que les Européens ont fait sur les bords de cette fameuse rivière est une factorerie des Portugais, et c’est à cela qu’on doit attribuer l’usage que les Nègres font encore d’un grand nombre de mots de la langue portugaise. Les Hollandais, les Français, les Anglais ont successivement eu des comptoirs sur la côte, mais le commerce de la Gambie a été pendant longtemps un monopole des Anglais. On voit dans les voyages de Francis Moore ce qu’étaient, en 1730, les établissements de la compagnie anglaise sur les bords de cette rivière. Alors la seule factorerie de James avait un gouverneur, un sous-gouverneur, deux autres principaux officiers, huit facteurs, treize écrivains, vingt employés subalternes, une compagnie de soldats, trente-deux Nègres domestiques, des barques, des chaloupes, des canots avec leurs équipages. Elle avait, en outre, huit factoreries subordonnées en différentes parties de la rivière.
Depuis ce temps-là, le commerce des Européens devenant libre dans cette partie de l’Afrique fut presque anéanti. Les Anglais n’y envoient plus que deux ou trois navires par an, et je sais que ce qu’ils en exportent ne s’élève pas à plus de vingt mille livres sterling. Les Français et les Danois y font encore quelque trafic, et les Américains des Etats-Unis ont essayé dernièrement d’y envoyer quelques navires.
Les marchandises qu’on porte d’Europe dans la rivière de Gambie consistent en armes à feu, munitions, ferrements, liqueurs spiritueuses, tabac, bonnets de coton, une petite quantité de drap large, quelque quincaillerie, un petit assortiment des marchandises des Indes, de la verroterie, de l’ambre et quelques autres bagatelles. On reçoit en échange des esclaves, de la poudre d’or, de l’ivoire, de la cire et des cuirs. Les esclaves sont le principal article ; malgré cela les Européens qui traitent dans la rivière de Gambie n’en tirent pas à présent tous ensemble mille par an.
La plupart de ces infortunés sont conduits de l’intérieur de l’Afrique sur la côte par des caravanes qui s’y rendent à des époques fixes. Souvent ils viennent de très loin, et leur langage n’est nullement entendu par les nations qui vivent dans le voisinage de la mer. Je dirai par la suite tout ce que j’ai recueilli sur la manière dont on se procure ces esclaves.
Lorsqu’à leur arrivée sur la côte, il ne se présente pas une prompte occasion de les vendre avec avantage, on les distribue dans les villages voisins, jusqu’à ce qu’il paraisse quelque navire d’Europe, ou que des spéculateurs nègres les achètent. Pendant ce temps-là, ces malheureux restent continuellement enchaînés deux à deux ; on les fait travailler à la terre ; et, je le dis avec peine, on leur donne très peu de nourriture, et on les traite fort durement.
Le nombre des acheteurs européens qui se trouvent sur la côte à l’arrivée des caravanes fait varier le prix des esclaves, mais ordinairement un homme de 16 à 25 ans, et d’une bonne constitution, se vend de 18 à 20 livres sterling.
L’on a déjà vu dans le chapitre précédent que les marchands nègres qui conduisent les caravanes s’appellent des slatées. Indépendamment des esclaves et des marchandises qu’ils portent pour les Blancs, ils vendent aux nègres de la côte du fer natif, des gommes odorantes, de l’encens et du schétoulou, ce qui signifie littéralement « beurre d’arbre », ou beurre végétal. Ce beurre est extrait d’une espèce de noix, par le moyen de l’eau bouillante, ainsi que je l’expliquerai par la suite. Il ressemble au beurre ordinaire, en a la consistance, et le remplace très bien. On s’en sert aussi au lieu d’huile. Les Nègres en font une grande consommation, et par conséquent il est toujours très recherché.
Pour payer les objets qu’ils reçoivent de l’intérieur, les habitants de la côte lui fournissent du sel, chose rare et précieuse dans ces contrées, ainsi que je l’ai fréquemment et péniblement éprouvé dans le cours de mon voyage. Cependant les Maures y en vendent aussi une quantité considérable, qu’ils tirent des marais salants du grand désert, et ils prennent en retour du blé, des toiles de coton et des esclaves.
Dans le premier temps des échanges de ces divers objets, le défaut de monnaie ou de quelque autre signe représentatif de la valeur des marchandises a dû souvent occasionner de l’embarras, et empêcher qu’on pût établir une juste balance. Pour remédier à cet inconvénient, les Nègres du centre de l’Afrique se servent de petits coquillages appelés corys ; et, dans la même intention, ceux de la côte ont adopté une méthode qui leur est, je crois, particulière.
Lorsque ces Nègres commencèrent à traiter avec les Européens, la chose dont ils faisaient le plus de cas était le fer, parce qu’il leur servait à faire des instruments de guerre et des instruments aratoires. Le fer devint bientôt la mesure d’après laquelle ils apprécièrent la valeur de tous les autres objets. Ainsi une certaine quantité de marchandise d’une ou d’autre espèce paraissant valoir une barre de fer donna naissance à la phrase mercantile d’une barre de marchandise. Par exemple, 20 feuilles de tabac furent considérées comme 1 barre de tabac, 1 gallon (4 pintes) de rhum comme 1 barre de rhum ; une barre d’une marchandise quelconque fut estimée le même prix qu’une barre de toute autre marchandise.
Toutefois, comme il devait nécessairement arriver que l’abondance ou la rareté des marchandises, proportionnellement aux demandes, mettrait leur valeur relative dans une fluctuation continuelle, on sentit le besoin d’une plus grande précision. Aujourd’hui les Blancs évaluent une barre de marchandise, quelle qu’elle soit, à 2 shillings : ainsi un esclave dont le prix est de 15 livres vaut 150 barres.
Certes, dans des échanges de cette nature, le marchand blanc a un très grand avantage sur le Nègre. Ce dernier est toujours très difficile à satisfaire, parce que, sentant son ignorance, il devient naturellement soupçonneux et indécis. Cela est au point que, toutes les fois que les Européens traitent avec un Africain, ils ne peuvent regarder le marché comme conclu que lorsque l’argent est compté et que le vendeur et l’acheteur se sont séparés.