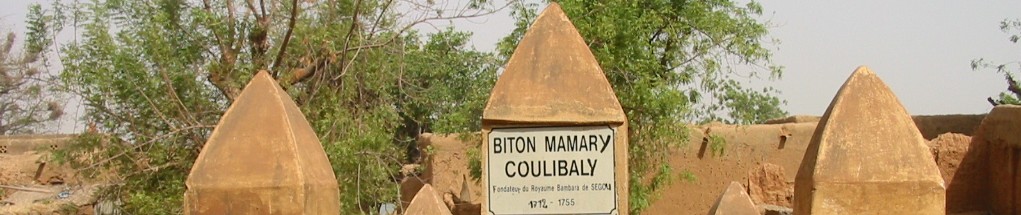XXI
Continuation des détails relatifs aux Mandingues. — Leurs idées sur les corps célestes et la figure de la terre. — Leurs opinions religieuses. — Croyance d’une autre vie. — Leurs maladies et les remèdes qu’ils emploient. — Cérémonies funéraires, amusements, occupations, aliments, arts, manufactures, etc.
Astronomie
Mesure du temps
Les Mandingues, et en général, je crois, tous les Nègres, n’ont point de méthode artificielle pour diviser le temps. Ils calculent les années par le nombre des saisons pluvieuses. L’année se partage en lunes, et ils comptent les jours par autant de soleils. Quant au jour, ils le divisent en matin, milieu du jour et soir ; ils le subdivisent encore, quand cela est nécessaire, en indiquant la place du soleil dans les cieux.
Soleil et Lune
J’ai souvent demandé à quelques-uns d’eux ce que devenait le soleil pendant la nuit, et si le matin nous reverrions le même soleil ou un autre que la veille. Mais je remarquai qu’ils regardaient ces questions comme très puériles. Ce sujet leur paraissait hors de la portée de l’intelligence humaine. Ils ne s’étaient jamais permis de conjectures, ni n’avaient fait d’hypothèses à cet égard.
La lune, par ses changements de forme, a un peu plus attiré leur attention. A la première apparition d’une nouvelle lune, qu’ils supposent être nouvellement créée, les naturels soit païens, soit mahométans, disent une courte prière. Ce semble être le seul culte que les païens rendent à l’Etre suprême.
Cette prière se prononce tout bas ; chacun tient ses mains devant son visage. La prière a pour objet, m’ont assuré diverses personnes, de rendre grâces à Dieu des bontés qu’il a eues pendant la lune passée, et de lui en demander la continuation pour la durée de celle qui commence. Quand ils ont fini de prier, ils crachent dans leurs mains, et s’en frottent le visage. Ce paraît être à peu près la même cérémonie qui se pratiquait chez les païens du temps de Job. (Chap. xxi., vers. 26, 27, 28.)
On fait aussi grande attention aux changements qu’éprouve cet astre pendant sa révolution, et l’on regarde comme une chose très fâcheuse de commencer un voyage ou toute autre opération importante dans le dernier quartier de la lune. Une éclipse, soit de lune, soit de soleil, est attribuée à la sorcellerie.
On s’occupe peu des étoiles. En général, l’astronomie est regardée par ces peuples comme une étude fort inutile, qui n’intéresse que les personnes adonnées à la magie.
Géographie
Leurs idées sur la géographie ne sont pas moins bornées. Ils s’imaginent que le monde est une plaine indéfiniment étendue, dont aucun œil encore n’a pu voir les limites, parce que, disent-ils, elles sont enveloppées de nuages et d’obscurité. Ils décrivent la mer comme une grande rivière d’eau salée, sur le bord de laquelle est situé un pays appelé Tobaudo dou (la terre des Blancs). A quelque distance de Tobaudo dou, ils placent un autre pays qu’ils prétendent être habité par des cannibales d’une taille gigantesque, nommés Koumi. Ils appellent ce pays Jong Sangdou (la terre où l’on vend les esclaves). De tous les pays de l’univers, le leur est celui qu’ils croient le meilleur, comme ils se croient le peuple le plus heureux. En conséquence, ils plaignent le sort des autres nations que la providence a placées dans des contrées moins fertiles, et sous de moins fortunés climats.
Théologie
Quelques opinions religieuses des Nègres, quoique mêlées de superstition et dictées par une crédulité ridicule, ne sont pas indignes d’attention. J’ai conversé avec des hommes de toutes les classes au sujet de leur foi, et je n’hésite pas à prononcer que la croyance d’un Dieu, ainsi que celle d’un Etat futur de peines et de récompenses, est universelle chez eux. Il est cependant à remarquer qu’excepté lors de la nouvelle lune et des cérémonies qu’elle occasionne les naturels païens croient inutile d’offrir au Tout-Puissant aucune prière ni supplications. Ils parlent de Dieu comme du créateur et du conservateur de toutes choses, mais ils le regardent comme un être si éloigné de nous et d’une si haute nature qu’il y a de la folie à supposer que les importunités des faibles mortels puissent changer les décrets ou renverser les lois de son infaillible sagesse. Si on leur demande pourquoi donc ils font des prières lorsqu’ils voient la nouvelle lune, ils répondent que l’usage en a fait une loi, et qu’ils le font parce que leurs pères l’on fait avant eux. Tel est l’aveuglement de l’homme que n’a point éclairé la lumière de la révélation !
Les Nègres supposent que le Tout-Puissant a confié les affaires de ce monde aux soins et à la direction d’esprits subordonnés, sur lesquels ils croient que les cérémonies magiques ont une grande influence. Un oiseau blanc suspendu à la branche d’un certain arbre, une tête de serpent, quelques poignées de fruits, sont des offrandes qu’emploient souvent la superstition et l’ignorance pour conjurer la colère ou se concilier la bienveillance de ces agents tutélaires. Au reste, il arrive rarement que les Nègres fassent de leurs opinions religieuses un sujet de conversation. Lorsqu’on les interroge en particulier sur leurs idées d’une vie future, ils s’en expriment avec un grand respect, mais ils tâchent d’abréger la discussion en disant mo o mo inta allo (personne ne sait rien là-dessus). Ils se contentent, disent-ils, de suivre dans les diverses occasions de la vie les leçons et les exemples de leurs ancêtres, et lorsque ce monde ne leur offre ni jouissances ni consolations ils tournent des regards inquiets vers un autre, qu’ils supposent devoir être mieux assorti à leur nature, mais sur lequel ils ne se permettent ni dissertations ni vaines conjectures.
Vie et Maladie
Les Mandingues parviennent rarement à une extrême vieillesse. A quarante ans, la plupart ont des cheveux gris et sont couverts de rides. Très peu vont au-delà de cinquante ou soixante ans. Ils calculent, comme je l’ai dit, le nombre de leurs années par celui des saisons pluvieuses dont il n’y a qu’une par an.
Ils distinguent chacune de ces années par un nom particulier, relatif à quelque circonstance remarquable qui a eu lieu pendant son cours. Ainsi, ils disent l’année de la guerre du Farbanna, celle de la guerre du Kaarta, l’année dans laquelle Gadou fut pillé, etc. Je ne doute point qu’en plusieurs endroits l’année 1796 ne soit nommée Tobaubo tambi sang (« l’année dans laquelle l’homme blanc a passé »), cette particularité devant naturellement former une époque dans leur histoire traditionnelle.
Quoique la longévité soit rare parmi les Nègres, il ne m’a point paru que les maladies y fussent communes. Leurs aliments simples, leur vie active les préservent de plusieurs maux qui font le tourment d’une vie oisive et voluptueuse. Les fièvres et les flux de ventre sont leurs indispositions les plus communes et les plus dangereuses. Pour y remédier, ils emploient en général les saphis qu’ils appliquent à différentes parties du corps, et ils pratiquent beaucoup d’autres cérémonies superstitieuses, dont quelques-unes sont assez bien imaginées pour inspirer au malade l’espoir de son rétablissement et détourner son esprit de l’idée du danger.
Mais j’ai quelquefois remarqué chez eux un genre de traitement plus systématique. Au premier accès de fièvre, lorsque le malade se plaint de froid, on le place souvent dans une espèce de bain de vapeur, ce que l’on exécute en étendant sur des cendres chaudes des branches de nauclea orientalis, sur lesquelles on couche le malade enveloppé dans un grand drap de coton ; on arrose alors les branches de gouttes d’eau, qui, parvenant entre les interstices des cendres chaudes, couvrent bientôt le patient d’un nuage de vapeurs ; on le laisse en cet état jusqu’à ce que les charbons soient presque éteints. Ce procédé occasionne, pour l’ordinaire, une transpiration abondante et soulage singulièrement le malade.
Pour guérir la dysenterie, ils emploient l’écorce de différents arbres réduite en poudre, qu’ils mêlent avec les aliments du malade. Mais ce procédé réussit ordinairement fort mal.
Les autres maladies auxquelles les Nègres sont sujets sont le tétanos, l’éléphantiasis, et une lèpre du plus mauvais genre. Celle-ci se manifeste, au commencement, par des taches scorbutiques qui paraissent sur différentes parties du corps, et qui finissent par se fixer aux mains et aux pieds. La peau s’y sèche et se fendille en plusieurs endroits. Enfin les extrémités des doigts enflent, s’ulcèrent. Le pus qui en sort est âcre et fétide ; les ongles tombent, les os des doigts se carient et se séparent des jointures. Le mal continue de faire ainsi des progrès, et croît souvent au point que le malade perd tous les doigts, tant des mains que des pieds. Ses membres eux-mêmes tombent quelquefois, détruits par cette cruelle maladie que les Nègres appellent balla jou (incurable).
Le ver de Guinée est aussi très commun dans certains endroits, surtout au commencement de la saison pluvieuse. Les Nègres attribuent ce mal, qui a été décrit par plusieurs auteurs, aux mauvaises eaux : ils prétendent que ceux qui boivent des eaux de puits y sont plus sujets que ceux qui boivent des eaux courantes. Ils attribuent à la même cause le gonflement des glandes du cou, le goitre, qui est très commun dans quelques parties du Bambara. Je remarquai aussi, dans les pays intérieurs, quelques exemples de gonorrhée simple, mais jamais je n’ai vu la vraie maladie vénérienne. A tout prendre, il m’a paru que les Nègres étaient meilleurs chirurgiens que médecins. Je les ai trouvés heureux dans le traitement des fractures et des dislocations. Leurs éclisses, leurs bandages sont fort simples et faciles à ôter. On couche le malade sur une natte douce, et l’on baigne souvent le membre fracturé avec de l’eau fraîche. Ils ouvrent tous les abcès par le moyen du feu, et les pansements se font avec des feuilles lisses, du beurre de shea ou de la bouse de vache, suivant que le cas leur paraît le requérir. Près de la côte où ils peuvent se procurer des lancettes, ils pratiquent quelquefois la saignée, et dans les cas d’inflammation locale ils font usage d’un genre curieux de ventouse. Elle consiste à faire des incisions à la partie affectée et à y appliquer une corne de bœuf, à l’extrémité de laquelle est un petit trou. L’opérateur prend ensuite dans la bouche un morceau de cire ; puis, appliquant ses lèvres au trou, il pompe l’air de la corne et, par un mouvement adroit de sa langue, ferme le trou avec la cire. Ce procédé répond ordinairement bien au but pour lequel on l’emploie, et produit en général un écoulement abondant.
Mort
Lorsqu’il meurt un personnage important, les parents et amis se réunissent et manifestent leur chagrin par de grands et lugubres cris. On tue un bœuf ou une chèvre pour les personnes qui viennent assister aux funérailles. La cérémonie a lieu, en général, le soir du jour même de la mort. Les Nègres n’ont point de lieu de sépulture déterminé ; souvent ils creusent la fosse dans le sol même de la hutte du défunt, ou sous quelque arbre qu’il affectionnait. Le corps est vêtu de coton blanc et enveloppé dans une natte. Il est porté au tombeau, à l’entrée de la nuit, par les parents. Si la fosse est hors de l’enceinte de la ville, on met dessus des branches épineuses, pour empêcher les loups de déterrer le corps, mais je n’ai jamais remarqué que l’on couvrît le tombeau d’aucune pierre destinée à servir de monument ou a décoration.
Arts
Jusqu’ici, j’ai considéré les Nègres principalement sous le point de vue moral, et je me suis borné aux traits les plus prononcés de leur caractère. Leurs amusements domestiques, leurs occupations, leurs aliments, leurs arts, et quelques autres objets dépendants de ceux-ci, méritent aussi quelques détails.
Musique
Dans divers endroits de mon journal, j’ai eu occasion de dire quelques mots de leur musique et de leur danse. J’ai à ajouter, sur le premier de ces articles, une liste de leurs instruments de musique, dont les principaux sont le kounting, espèce de guitare à trois cordes ; le korro, grande harpe à dix-huit cordes ; le simbing, petite harpe à sept cordes ; le balafou, instrument composé de vingt morceaux de bois dur, au-dessous desquels sont des gourdes coupées en forme de coquilles qui en augmentent le son ; le tang-tang, tambour qui est ouvert à son extrémité inférieure ; et enfin le tabala, grand tambour qui s’emploie ordinairement pour répandre l’alarme dans le pays. Outre cela, ils font usage de petites flûtes, de cordes d’arc, de dents d’éléphant et de cloches. Dans toutes leurs danses, tous leurs concerts, le battement des mains semble faire une partie nécessaire du chœur.
Poésie
A l’amour de la musique s’allie naturellement le goût de la poésie, et, heureusement pour les poètes d’Afrique, ils sont à peu près exempts de l’indigence et de l’abandon, qui trop souvent font, dans les pays civilisés, le partage des favoris des muses. Ils consistent en deux classes :
-les plus nombreux sont les chanteurs, qu’on appelle jilly kea ; j’en ai parlé précédemment. Dans chaque ville on en trouve un ou plusieurs. Ils improvisent des chansons en l’honneur de leurs chefs, ou de toutes les personnes disposées à donner un solide dîner pour un vain compliment. Une fonction plus noble de leur profession consiste à raconter les événements historiques de leur pays. C’est pour cela qu’à la guerre ils accompagnent les soldats sur le champ de bataille, afin d’exciter en eux une noble émulation en leur racontant les hauts faits de leurs ancêtres.
-L’autre classe est composée de dévots, à la fois mahométans, qui parcourent le pays en chantant des hymnes pieux et en faisant des cérémonies religieuses pour attirer les bonnes grâces du Tout-Puissant.
Soit qu’il s’agisse de détourner quelque malheur, ou d’assurer le succès d’une grande entreprise, ces deux genres de poètes ambulants sont considérés et respectés par leurs compatriotes. On recueille pour eux d’abondantes contributions.
Nourriture
La nourriture ordinaire des Nègres varie un peu, suivant les divers districts que j’ai vus. En général, les gens de condition libre déjeunent à la pointe du jour, avec de la bouillie de farine et d’eau, à laquelle on mêle un peu de fruit de tamarin, pour y donner un goût acide. Vers deux heures de l’après-midi, on mange le plus ordinairement une espèce de pouding, fait avec un peu de beurre de shea. C’est le souper qui est le principal repas ; on ne le commence guère avant minuit. Il consiste principalement en kouskous mêlé d’un peu de viande quelconque, ou de beurre de shea. Les kafirs, ainsi que les mahométans, ne se servent en mangeant que de la main droite.
Le breuvage des Nègres paysans est de la bière et de l’hydromel. Ils boivent souvent avec excès, tant de l’un que de l’autre. Ceux qui sont convertis au mahométisme ne boivent que de l’eau. Les naturels de toutes classes prennent du tabac et en fument. Leurs pipes sont de bois, et se terminent par un bowl de terre d’une forme assez curieuse. Dans les contrées de l’intérieur, le luxe le plus recherché est le sel. Un Européen serait fort surpris de voir un enfant sucer un morceau de sel gommé comme un morceau de sucre ; c’est cependant ce que j’ai vu souvent. Néanmoins, dans ces mêmes contrées, la classe la plus pauvre des habitants a si rarement la faculté de se satisfaire sur ce précieux article que dire qu’un homme mange du sel avec ses aliments c’est la même chose que de dire qu’il est riche. J’ai moi-même beaucoup souffert de la rareté de cette denrée. Le long usage des aliments végétaux donne un si grand désir de sel qu’on ne peut décrire ce besoin.
Paresse ?
Les Nègres, en général, et surtout les Mandingues, sont représentés par les habitants blancs des côtes comme des hommes indolents et paresseux. C’est, je crois, avec peu de raison qu’on leur fait ce reproche. La nature du climat est sans doute peu favorable à une grande activité. Cependant, il n’est pas juste d’appeler indolent un peuple qui vit non des productions spontanées de la terre, mais de celles que lui-même lui arrache par la culture. Peu de gens travaillent plus rigoureusement, quand il le faut, que les Mandingues ; mais, n’ayant pas l’occasion facile de tirer parti des produits superflus de leur travail, ils se contentent de cultiver autant de terre qu’il en faut pour fournir à leur subsistance. Les travaux des champs leur donnent beaucoup d’emploi pendant les pluies, et dans la saison sèche les gens qui vivent près des grandes rivières s’occupent beaucoup de la pêche. Ils prennent le poisson dans des paniers d’osier, ou avec de petits filets de coton. Pour le conserver, ils le font d’abord sécher au soleil, puis ils le frottent avec du beurre de shea, afin de l’empêcher de se moisir. D’autres habitants s’adonnent à la chasse.
Commerce
Le commerce de la Gambie a été pendant longtemps un monopole des Anglais. On voit dans les voyages de Francis Moore ce qu’étaient, en 1730, les établissements de la compagnie anglaise sur les bords de cette rivière. Alors, la seule factorerie de James avait un gouverneur, un sous-gouverneur, deux autres principaux officiers, huit facteurs, treize écrivains, vingt employés subalternes, une compagnie de soldats, trente-deux Nègres domestiques, des barques, des chaloupes, des canots avec leurs équipages. Elle avait, en outre, huit factoreries subordonnées en différentes parties de la rivière.
Depuis ce temps-là, le commerce des Européens, devenant libre dans cette partie de l’Afrique, fut presque anéanti. Les Anglais n’y envoient plus que deux ou trois navires par an, et je sais que ce qu’ils en exportent ne s’élève pas à plus de vingt mille livres sterling. Les Français et les Danois y font encore quelque trafic, et les Américains des Etats-Unis ont essayé dernièrement d’y envoyer quelques navires.
Les marchandises qu’on porte d’Europe dans la rivière de Gambie consistent en armes à feu, munitions, ferrements, liqueurs spiritueuses, tabac, bonnets de coton, une petite quantité de drap large, quelque quincaillerie, un petit assortiment des marchandises des Indes, de la verroterie, de l’ambre et quelques autres bagatelles.
On reçoit en échange des esclaves, de la poudre d’or, de l’ivoire, de la cire et des cuirs. Les esclaves sont le principal article ; malgré cela, les Européens qui traitent dans la rivière de Gambie n’en tirent pas à présent tous ensemble mille par an. La plupart de ces infortunés sont conduits de l’intérieur de l’Afrique sur la côte, par des caravanes qui s’y rendent à des époques fixes. Souvent ils viennent de très loin, et leur langage n’est nullement entendu par les nations qui vivent dans le voisinage de la mer. Je dirai par la suite tout ce que j’ai recueilli sur la manière dont on se procure ces esclaves.
Lorsqu’à leur arrivée sur la côte il ne se présente pas une prompte occasion de les vendre avec avantage, on les distribue dans les villages voisins, jusqu’à ce qu’il paraisse quelque navire d’Europe, ou que des spéculateurs nègres les achètent. Pendant ce temps-là, ces malheureux restent continuellement dans les fers.
Industrie
Textile
La toile tissée est le plus souvent teinte d’une lessive à base de tiges de millet que l’on fait sécher au soleil. Lorsqu’on veut s’en servir, on en réduit en poudre une certaine quantité que l’on mêle avec la lessive dont je viens de parler. La couleur qui résulte, tant d’une de ces opérations que de l’autre, a une teinte purpurine ; et elle égale, à mon avis, le plus beau bleu de l’Inde ou de l’Europe. Cette toile est coupée en pièces de différentes grandeurs, et l’on en fait des vêtements que l’on coud avec des aiguilles fabriquées dans le pays.
L’art de tisser, celui de teindre et celui de coudre s’apprenant sans peine, ceux qui les pratiquent ne sont pas considérés en Afrique comme exerçant une profession particulière, car il n’y a guère d’esclave qui ne sache tisser, ni d’enfant qui ne sache coudre.
Tanneries
Les seuls artisans qui soient reconnus pour tels parmi les Nègres et qui se regardent comme exerçant un métier qui leur soit propre sont les ouvriers en cuir et en fer.
On appelle les premiers karrankée, ou, comme on le prononce quelquefois, gaungay. Il s’en trouve dans presque toutes les villes ; très souvent, ils parcourent la campagne pour y pratiquer leur art. Ils tannent et préparent le cuir très promptement, en faisant d’abord tremper la peau dans un mélange de cendres de bois et d’eau, jusqu’à ce qu’elle perde son poil. Ils emploient ensuite, comme astringent, les feuilles pilées d’un arbre appelé gou. Ils se donnent beaucoup de peine pour rendre le cuir aussi souple qu’il est possible ; ils le frottent à cet effet entre leurs mains, et le battent sur une pierre. Les peaux de bœuf servent principalement à faire des sandales ; elles demandent par conséquent moins de soin à préparer que les peaux de chèvre et de mouton, qu’on emploie pour couvrir les carquois et les saphis, et pour faire des gaines de couteaux, des fourreaux d’épée, des baudriers, des poches et plusieurs ornements. Ces peaux se teignent ordinairement en jaune ou en rouge. On fait le rouge avec des tiges de millet réduites en poudre et le jaune avec la racine d’une plante dont j’ai oublié le nom.
Forges
Les ouvriers en fer ne sont pas aussi nombreux que les karrankées, mais ils paraissent avoir étudié leur art avec le même soin ; les Nègres de la côte, ayant la facilité d’acheter des Européens du fer à très bon marché, ne fabriquent jamais eux-mêmes cet article ; mais, dans l’intérieur, les naturels fondent et forgent cet utile métal en assez grande quantité, non seulement pour se procurer toutes les armes, tous les ustensiles dont ils ont besoin, mais même pour en faire un objet de commerce avec quelques nations voisines. Pendant mon séjour à Kamalia, il y avait à peu de distance de la hutte où j’étais logé un fourneau pour fondre le fer, et le propriétaire, non plus que ses ouvriers, ne me firent point un secret de la manière dont ils conduisaient leurs travaux ; ils me permirent d’examiner le fourneau et de les aider à broyer le minerai.
Ce fourneau était une tour circulaire d’argile, d’environ dix pieds de haut sur trois pieds de diamètre, ceinte en deux endroits avec des lianes, pour empêcher l’argile de se fendre et de se briser en morceaux par la violence de la chaleur. Autour de la partie inférieure, de niveau avec la terre, mais moins bas que le fond du fourneau qui était un peu concave, étaient sept trous, dans chacun desquels il y avait trois tuyaux d’argile. Ces trous étaient bouchés de façon que l’air ne pouvait entrer dans le fourneau qu’en passant dans ces tubes, par l’ouverture et la clôture desquels on réglait le feu. On faisait ces tubes en moulant un mélange d’argile et d’herbe sur un rouleau de bois uni. Aussitôt que l’argile commençait à durcir, on retirait le rouleau et on laissait le tube vide sécher au soleil. Le minerai que je vis était pesant, d’un rouge obscur, avec des taches grisâtres. On le broyait en morceaux, gros à peu près comme un œuf de poule. On mettait d’abord dans le fourneau un fagot de bois sec, qu’on recouvrait d’une grande quantité de charbon ; celui-ci s’apporte des forêts, tout préparé. Sur cela on étendait une couche de minerai, puis une autre de charbon, et ainsi de suite jusqu’à ce que fourneau fût plein. Le feu se mettait par un des tubes, et on le soufflait pendant quelques moments avec des soufflets de peaux de chèvre. L’opération allait lentement d’abord, et il se passait quelques heures avant que la flamme parût au-dessus du fourneau ; mais ensuite elle brûlait avec violence pendant toute la première nuit, et les personnes qui en avaient soin y remettaient plusieurs fois du charbon. Le jour suivant, le feu était moins ardent ; on retirait quelques-uns des tubes, et on laissait arriver l’air plus librement au foyer ; la chaleur était encore très forte, et l’on voyait une flamme bleuâtre s’élever à quelques pieds au-dessus du fourneau. Le troisième jour, on enlevait tous les tubes, dont plusieurs avaient leurs extrémités vitrifiées par la chaleur ; mais on ne retirait le métal que quelques jours après, lorsque tout était parfaitement refroidi. On abattait alors une partie du four, et le fer se montrait sous la forme d’une grande masse irrégulière, à laquelle adhéraient plusieurs morceaux de charbon. Il était sonore, et lorsqu’on en brisait quelque partie la fracture présentait un aspect grainu comme un morceau d’acier rompu. Le propriétaire me dit que plusieurs portions de cette masse n’étaient bonnes à rien, mais qu’il s’y trouvait assez de bon fer pour payer la peine de l’ouvrier. De ce fer, ou plutôt de cet acier, on fait divers instruments, en le faisant chauffer à plusieurs reprises dans une forge dont la chaleur est excitée par une paire de doubles soufflets, de construction très simple, puisqu’ils ne consistent qu’en deux peaux de chèvre. Les tuyaux de ces deux soufflets se réunissent avant d’entrer dans la forge et fournissent un courant d’air constant et très régulier. Le marteau, les tenailles, l’enclume sont tous fort simples, et la main-d’œuvre, surtout en ce qui concerne les couteaux et les lances, n’est pas sans mérite. Le fer, il est vrai, est dur et cassant : il a besoin d’être beaucoup travaillé avant de pouvoir servir à l’usage qu’on en veut faire.
La plupart des forgerons africains connaissent aussi l’art de fondre l’or. Ils se servent à cet effet d’un sel alcalin provenant d’une lessive de tiges de maïs brûlées qu’ils font évaporer jusqu’à siccité. Ils tirent aussi l’or en fil et en font plusieurs ornements, dont quelques-uns sont exécutés avec beaucoup d’intelligence et de goût.
Telles sont les principales notions que j’ai pu recueillir sur les arts et les manufactures des régions de l’Afrique que j’ai parcourues. Je pourrais ajouter, quoique la chose soit peu digne d’observation, que dans le Bambara et le Kaarta les naturels font de très beaux paniers, des chapeaux et d’autres articles d’ornement ou d’utilité avec des joncs qu’ils teignent de diverses couleurs. Ils couvrent aussi leurs calebasses de cannes entrelacées, qu’ils teignent de la même façon.
Dans les pénibles occupations que je viens de décrire, le maître et ses esclaves travaillent ensemble sans distinction de supériorité. On ne connaît point en Afrique de serviteurs salariés, c’est-à-dire de personnes de condition libre qui travaillent pour une rétribution. Cette observation me conduit naturellement à parler des esclaves et des divers moyens par lesquels ils sont réduits à ce misérable état de servitude. On trouve des hommes de cette malheureuse classe dans toutes les parties de ce vaste pays : ils forment une branche considérable de commerce, tant avec les pays qui bordent la Méditerranée qu’avec les nations européennes.