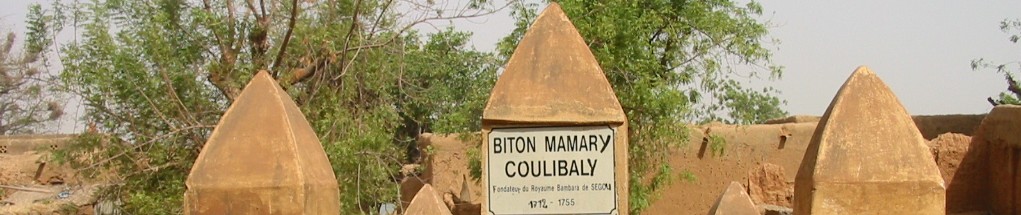La route était escarpée, parsemée de roches, et comme mon cheval s’était blessé le pied en venant de Bammakou il marchait doucement et avec beaucoup de peine. Dans plusieurs endroits, la montée était si raide, ou la pente si rapide, que s’il eût fait un faux pas, il se serait infailliblement précipité et mis en pièces. Les bergers, occupés de faire route, ne s’occupaient pas beaucoup de moi ni de mon cheval et marchaient en avant à une distance considérable. Vers onze heures, mes compagnons de voyage étant environ à un quart de mille de moi, je m’arrêtai près d’un petit ruisseau pour boire un peu d’eau. J’entendis quelques personnes qui s’appelaient l’une l’autre, et tout à coup partit un grand cri qui semblait provenir d’une personne à qui il était arrivé un grand malheur. J’imaginai qu’un lion s’était jeté sur un des bergers, et je remontai à cheval pour mieux voir ce qui se passait. Cependant le bruit cessa. Marchant lentement vers le lieu d’où il était parti, j’appelai à haute voix ; je ne reçus aucune réponse, mais au bout de quelques moments j’aperçus un des bergers couché sur les grandes herbes, près du chemin. Quoique je ne visse sur lui aucune trace de sang, je conclus qu’il était mort ; mais lorsque je m’en approchai il me dit tout bas de m’arrêter, ajoutant qu’une troupe d’hommes armés avait enlevé son compagnon et lui avait tiré à lui-même deux flèches dans sa fuite. Je m’arrêtai pour réfléchir sur le parti que j’avais à prendre et, regardant autour de moi, je vis à peu de distance un homme assis sur une souche d’arbre. Je distinguai aussi les têtes de six ou sept autres qui étaient assis dans l’herbe et qui tenaient dans leurs mains des mousquets. Je vis qu’il n’y avait aucun espoir de leur échapper, et je me décidai à marcher vers eux ; en avançant, je me flattais que c’étaient des chasseurs d’éléphants, et pour entamer la conversation je leur demandai s’ils avaient tué quelque chose. Sans me faire réponse, l’un d’eux m’ordonna de descendre, puis, paraissant se souvenir de quelque chose, il me fit signe avec la main de continuer mon chemin. Je passai donc, et j’avais déjà traversé avec quelque peine un petit ruisseau lorsque j’entendis quelqu’un appeler. Regardant en arrière, je vis ceux que j’avais pris pour des chasseurs d’éléphants qui couraient après moi, et qui me criaient de revenir. Je m’arrêtai jusqu’à ce qu’ils fussent tout près de moi. Ils me dirent alors que le roi des Foulahs les avait envoyés pour me mener, moi, mon cheval et tout ce qui m’appartenait, à Fouladou, et que par conséquent il fallait que je retournasse avec eux. Je les suivis sans hésiter, et nous fîmes ensemble près d’un quart de mille sans dire une parole. Etant arrivés dans un endroit obscur du bois, l’un d’eux dit en langage mandingue : « Ce lieu-ci sera bon » ; et dans le même moment il m’arracha mon chapeau de dessus la tête. Je n’étais pas exempt de craintes ; cependant je résolus de montrer aussi peu de frayeur qu’il serait possible. C’est pourquoi je leur dis que si l’on ne me rendait pas mon chapeau je n’irais pas plus loin. Mais, avant qu’on eût eu le temps de me répondre, l’un d’eux tira son couteau et, coupant un bouton de métal qui restait à ma veste, il le mit dans sa poche. Leurs intentions n’étaient pas douteuses : je pensais que, plus il leur serait facile de me voler, moins j’aurais à craindre. Je les laissai donc sans résistance fouiller dans mes poches et examiner toutes les parties de mon vêtement, ce qu’ils firent avec la plus scrupuleuse exactitude. Mais, en observant que j’avais un gilet sous ma veste, ils exigèrent que je les ôtasse l’un et l’autre ; et enfin, pour ne rien négliger, ils me dépouillèrent tout nu ; mes demi-bottes même, quoique la semelle de l’une fût attachée à mon pied avec une longe de bride, furent examinées avec soin. Tandis qu’ils considéraient le fruit de leur pillage, je les suppliai avec insistance de me rendre ma boussole de poche. Elle était par terre, et je m’en approchais pour la leur indiquer ; l’un des bandits, croyant que je voulais la prendre, arma son mousquet et jura qu’il allait m’étendre sur la place si j’osais mettre la main dessus. Quelques-uns s’en allèrent ensuite avec mon cheval ; les autres restèrent, délibérant s’ils me laisseraient entièrement nu ou s’ils me permettraient de prendre quelque chose pour me mettre à l’abri du soleil. Enfin l’humanité l’emporta : ils me rendirent la plus mauvaise des deux chemises et une grande culotte ; et pendant qu’ils s’éloignaient l’un d’eux me rejeta mon chapeau, dans la coiffe duquel j’avais mis mes notes. Ce fut probablement pour cela qu’ils ne se soucièrent pas de le garder.