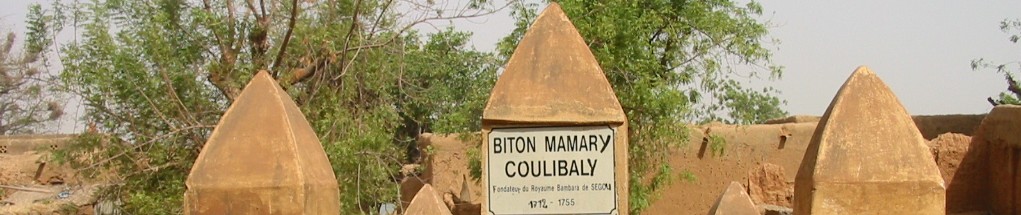Le maître d’école, aux soins duquel Karfa m’avait confié pour le temps de son absence, était un homme doux, paisible, et dont les manières étaient affables ; il s’appelait Fankouma et, quoique fort strictement attaché à la religion de Mahomet, il n’était nullement intolérant dans ses principes à l’égard des personnes qui ne pensaient pas comme lui. Il passait beaucoup de temps à lire, et l’enseignement de la jeunesse semblait faire son amusement autant que son occupation. Son école était composée de dix-sept garçons, pour la plupart fils de kafirs, et de deux filles dont l’une était celle de Karfa. Les filles recevaient leur instruction pendant la journée, mais les garçons prenaient une première leçon à la lumière d’un grand feu avant la pointe du jour et une deuxième le soir, car, étant considérés pendant le temps de leur éducation comme esclaves domestiques de leur professeur, ils étaient occupés toute la journée à planter du maïs, à apporter du bois pour le feu, et aux autres travaux serviles de la maison.
Outre le Koran et un ou deux volumes de commentaires faits sur ce livre, le maître d’école possédait plusieurs manuscrits qu’il avait en partie achetés à des marchands maures et en partie empruntés à des buschréens du voisinage et copiés avec beaucoup de soin. J’avais eu occasion de voir dans le cours de mon voyage d’autres manuscrits. En parlant au maître d’école de ceux que j’avais vus et en l’interrogeant sur ceux qu’il me montrait, je découvris que les Nègres possédaient entre autres une version arabe du Pentateuque de Moïse, qu’ils appellent Taureta la Mousa. On estime tant cet ouvrage qu’il se vend quelquefois le prix d’un esclave de choix. Ils ont aussi une version des Psaumes de David, Zabora Dawidi, et enfin le livre d’Isaïe qu’ils appellent Lingeeli la Isa, et qui est fort estimé.
Je soupçonne, il est vrai, qu’il y a dans tous ces livres des interpolations de quelques dogmes de Mahomet, car j’ai distingué dans plusieurs passages le nom de ce prophète ; peut-être aussi ce fait eût-il pu s’expliquer différemment si j’avais mieux su l’arabe. Au moyen de ces livres, plusieurs des Nègres convertis ont acquis quelques connaissances des événements les plus remarquables de l’Ancien Testament : l’histoire d’Adam et Eve, la mort d’Abel, les vies d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, l’histoire de Joseph et de ses frères, celles de Moïse, de David, de Salomon, etc., m’ont été racontées par plusieurs personnes en langage mandingue avec assez d’exactitude. Je ne fus pas plus surpris d’entendre les Nègres me parler de ces faits qu’ils ne le furent eux-mêmes de voir que je les connaissais ; car, quoique les Nègres, en général, aient une grande idée de la richesse et du pouvoir des Européens, je pense que ceux d’entre eux qui sont convertis à la foi mahométane pensent assez légèrement de nos connaissances supérieures en matière religieuse. Les Blancs qui viennent traiter sur les bords de la mer ne prennent aucun soin pour détruire ce malheureux préjugé. Ils pratiquent toujours en secret l’exercice de leur culte, et condescendent rarement à avoir avec les Nègres quelque conversation familière et instructive. Je m’étonnais donc moins que je ne regrettais de voir que, tandis que la religion mahométane avait contribué à répandre quelques rayons de lumière parmi ces pauvres peuples, la précieuse lumière du christianisme n’avait pu pénétrer chez eux. Je ne pouvais que m’affliger de ce que, la côte d’Afrique étant connue et fréquentée par les Européens depuis plus de deux cents ans, les Nègres étaient encore absolument étrangers aux dogmes de notre sainte religion. Nous mettons de l’intérêt à tirer de l’obscurité les opinions et les monuments des anciens peuples ; nous recherchons les beautés de la littérature arabe ou asiatique, etc. Et, tandis que nos bibliothèques sont meublées de la science de divers pays, nous distribuons d’une main avare les lumières de la religion aux nations aveugles de la terre. Les naturels de l’Asie tirent peu d’avantage, à cet égard, de leurs rapports avec nous, et je crains que ces pauvres Africains que nous traitons de barbares ne nous regardent comme une race de redoutables mais ignorants païens.
Lorsque je montrai la grammaire arabe de Richardson à quelques slatées sur la Gambie, ils furent étonnés d’apprendre que des Européens pouvaient entendre et écrire la langue sacrée de leur religion. D’abord ils soupçonnèrent que ce livre pouvait avoir été écrit par quelque esclave arabe acheté à la côte ; mais, en l’examinant de plus près, ils convinrent qu’il n’y avait point de buschréens qui pût écrire de si beaux caractères arabes, et l’un d’eux offrit de me donner un âne et six barres de marchandises si je voulais lui donner ce livre. Peut-être une légère et courte instruction du christianisme, telle qu’on la trouve dans quelques catéchismes destinés aux enfants, imprimée avec soin en arabe, suffirait-elle pour produire parmi ces peuples un merveilleux effet. La dépense ne serait qu’une bagatelle, la curiosité engagerait plusieurs personnes à lire ce livre, et la supériorité évidente qu’il aurait sur tous les manuscrits, tant par l’élégance des caractères que par la modicité du prix, pourrait enfin lui obtenir une place parmi les livres classiques de l’Afrique.
Les réflexions que je me suis permises sur cet important sujet se présentèrent d’elles-mêmes à mon esprit, en voyant l’encouragement qu’on donnait en plusieurs parties de l’Afrique à l’instruction telle qu’on l’a dans le pays. Je remarquai à Kamalia que les écoliers étaient presque tous des enfants de païens. Leurs parents ne pouvaient donc avoir aucune prédilection pour la doctrine de Mahomet : leur but était l’éducation de leurs enfants et, si un système plus instructif se fût offert à eux, il aurait probablement été préféré. Les enfants ne manquaient pas non plus d’émulation, ce que leur maître cherchait à encourager. Lorsqu’un de ces élèves a lu en entier le Koran et fait un certain nombre de prières, le maître d’école prépare une fête ; l’écolier subit un examen, ou, pour m’exprimer à la manière européenne, prend ses degrés. J’ai assisté à trois inaugurations de cette espèce, et j’ai entendu avec plaisir les réponses claires et spirituelles que faisaient les élèves aux buschréens, qui dans ces occasions faisaient le rôle d’examinateurs. Lorsque ceux-ci étaient satisfaits de l’instruction et des talents du récipiendaire, on lui mettait en main la dernière page du Koran, en le priant de la lire tout haut. Quand il avait fini cette lecture, il pressait le papier contre son front et prononçait le mot amen ; sur quoi tous les buschréens se levaient et, lui serrant amicalement la main, lui donnaient le titre de buschréen.
Après qu’un élève a subi cet examen, on avertit ses parents qu’il a achevé son éducation et qu’il est à propos qu’ils rachètent leur fils, en donnant en échange au maître d’école un esclave ou sa valeur, ce qui se fait toujours quand les parents en ont le moyen ; sinon, le jeune homme reste esclave domestique du maître d’école jusqu’à ce qu’il puisse, par son industrie, amasser de quoi se racheter lui-même.