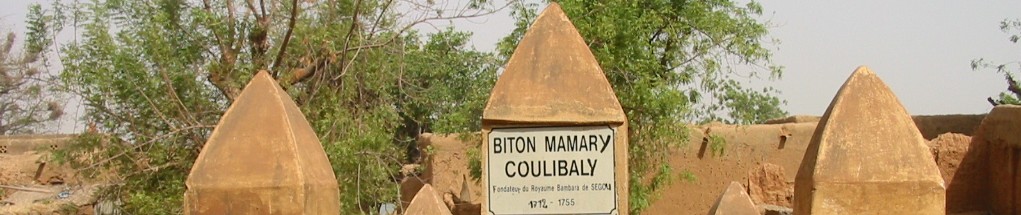Quoique j’approchasse ainsi du terme de ma fatigante route, et que j’eusse l’espoir de me retrouver bientôt au milieu de mes compatriotes, je ne pus sans émotion me séparer de mes malheureux compagnons de voyage, qu’attendaient dans une terre étrangère, la misère et la captivité. Pendant une pénible marche de plus de 500 milles anglais, exposés à l’action dévorante des feux du tropique, ces pauvres esclaves, accablés de bien plus de maux que moi, avaient eu pitié de mon sort. Souvent ils venaient d’eux-mêmes m’apporter de l’eau pour étancher ma soif ; le soir, ils rassemblaient des branches et des feuilles pour me préparer un lit lorsque nous couchions en plein air. Nous nous quittâmes avec des témoignages réciproques de regret et de bienveillance : des vœux et des prières étaient tout ce que je pouvais leur offrir, et ce fut pour moi une consolation d’apprendre qu’ils savaient que je n’avais rien de plus à leur donner.