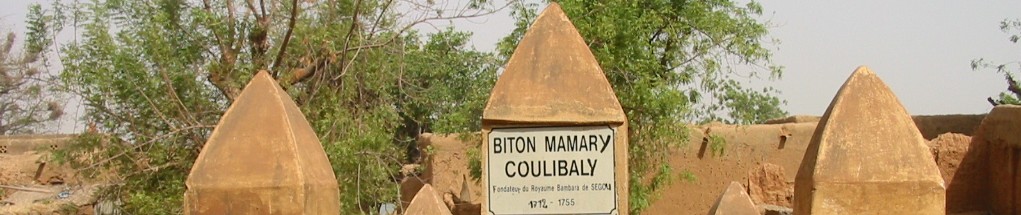XXII
Observations sur la servitude et la manière dont se font les esclaves en Afrique.
Nulle société, à quelque degré de civilisation qu’on la suppose, ne peut se passer d’une subordination quelconque, et d’une certaine inégalité, mais, toutes les fois que ces différences sont portées au point qu’une partie de la société dispose arbitrairement et des services et des personnes d’une autre portion, on peut donner à cet ordre de choses le nom de servitude. C’est dans cet état qu’ont vécu un grand nombre d’habitants noirs de l’Afrique depuis les époques les plus reculées de leur histoire ; sort d’autant plus fâcheux qu’ils n’ont à transmettre à leurs enfants d’autre héritage que cette triste condition.
Les esclaves en Afrique sont, je crois, relativement aux hommes libres, dans la proportion de trois contre un. Ils ne demandent d’autre salaire de leurs services que le vêtement et la nourriture, et ils sont traités avec douceur ou dureté, suivant la bonne ou mauvaise disposition des maîtres auxquels ils appartiennent. L’usage a cependant établi, relativement au traitement des esclaves, certaines règles qu’il est honteux de violer. Ainsi les esclaves domestiques, ou qui sont nés dans la maison du maître, sont traités avec plus de douceur que ceux qu’on a achetés à prix d’argent. L’autorité du maître sur le domestique, comme je l’ai dit ailleurs, ne s’étend pas au-delà d’une correction raisonnable. Le premier ne peut vendre son domestique sans l’avoir d’abord traduit en jugement devant les chefs du lieu (Dans les temps de famine, il est permis au maître de vendre un ou plusieurs de ses domestiques, à l’effet d’acheter des subsistances pour sa famille ; et, dans le cas d’insolvabilité du maître, les esclaves domestiques sont quelquefois saisis par les créanciers et le maître ne peut les racheter, et on peut les vendre pour payer ses dettes. Ce sont là les seuls cas dont je me souvienne dans lesquels les esclaves domestiques soient exposés à être vendus sans aucune faute de leur part.)
Mais ces restrictions à l’autorité du maître ne s’appliquent point aux prisonniers faits à la guerre, ni aux esclaves achetés. Ces misérables sont considérés comme des étrangers qui n’ont point de droit à la protection des lois. Leur propriétaire peut les traiter durement à son gré ou les vendre, s’il lui plaît, à des étrangers ; il y a même des marchés réguliers où l’on mène ces sortes d’esclaves pour les vendre. La valeur d’un esclave, aux yeux d’un acquéreur africain, augmente en raison de la distance à laquelle il est de son pays natal, car les esclaves qu’on achète à quelques journées de marche du lieu où ils ont pris naissance sont sujets à s’enfuir. Mais, lorsqu’ils en sont séparés par plusieurs royaumes, il leur est plus difficile d’échapper, et ils se résignent plus aisément à leur sort. A raison de cela, un mal-heureux esclave passe souvent d’un marchand à l’autre, jusqu’à ce qu’il ait perdu tout espoir de jamais retourner dans son pays. Ceux qu’achètent les Européens sur la côte sont ordinairement dans ce cas. Quelques-uns ont perdu la liberté dans les petites guerres dont je parlerai et qui ont lieu près des côtes. On les amène, pour la plupart, en grandes caravanes des pays intérieurs, dont plusieurs sont inconnus, même de nom, aux Européens. Les esclaves qui viennent ainsi du centre de l’Afrique peuvent se diviser en deux classes :
-la première comprend les esclaves de naissance, ou ceux qui sont nés de mères esclaves ;
-la seconde, ceux qui étant nés libres, sont tombés en servitude par des moyens quelconques.
Les premiers sont beaucoup plus nombreux que les autres, car les prisonniers faits à la guerre ou du moins dans les hostilités ouvertes et déclarées qu’exercent les uns envers les autres des royaumes en état de guerre sont en général de cette classe. J’ai déjà dit combien le nombre des hommes libres était peu considérable en Afrique, proportionnellement à celui des esclaves, et il faut observer que les gens de condition libre ont, même en guerre, de grands avantages sur les esclaves. Ils sont en général mieux armés, bien montés, et peuvent combattre ou fuir avec quelque espoir de succès. Mais les esclaves qui n’ont pour armes que l’arc et la lance, et dont plusieurs sont chargés de bagage, deviennent pour l’ennemi une proie facile. C’est ainsi que, dans la guerre que Mansong, roi de Bambara, porta dans le Kaarta, comme je l’ai raconté dans un chapitre précédent, il fit en un jour 900 prisonniers, parmi lesquels il n’y avait pas plus de 70 hommes libres. Je sus ce détail par Daman Jumma qui avait à Kemmou 30 esclaves ; tous furent faits pri-sonniers par Mansong. En outre, lorsqu’un homme libre est fait prisonnier, ses amis le rachètent quelquefois, en donnant pour lui deux esclaves en échange. Un es-clave pris n’a point d’espérance d’être ainsi racheté. A ces considérations, il faut ajouter que les slatées qui achètent des esclaves dans l’intérieur, et qui les condui-sent à la côte pour les vendre, préfèrent toujours, pour les employer à cette desti-nation, ceux qui ont vécu depuis leur enfance dans l’esclavage, sachant bien qu’accoutumés à la faim et à la fatigue ils sont plus en état que des hommes nou-vellement asservis de soutenir les travaux d’un long et pénible voyage. Quand ces esclaves sont parvenus à la côte, si les marchands ne trouvent pas à les vendre avec avantage, on ne manque pas de moyens de les faire vivre par leur travail, et ils sont beaucoup moins disposés à s’enfuir que ceux qui ont déjà goûté les douceurs de la liberté.
Les esclaves du second genre deviennent ordinairement tels par l’un des moyens suivants :
1) la guerre ;
2) la famine ;
3) l’insolvabilité ;
4) les délits.
Un homme libre, suivant les usages d’Afrique, peut devenir esclave s’il est pris. La guerre est la source qui produit le plus d’esclaves, comme probablement elle fut l’origine de l’esclavage. Il est naturel de croire qu’une nation ayant fait plus de captifs qu’elle n’en pouvait échanger, homme contre homme, les vain-queurs trouvèrent commode de garder leurs prisonniers et de les forcer à travailler, d’abord peut-être pour leur propre subsistance, et ensuite pour nourrir leurs maîtres. Quoi qu’il en soit, c’est un fait constant qu’en Afrique les prisonniers faits à la guerre deviennent esclaves du vainqueur. Lorsque le soldat faible ou malheu-reux implore la pitié de son ennemi victorieux, il renonce en même temps à tout droit à sa liberté et rachète sa vie au prix de son indépendance.
Dans un pays partagé en 1000 petits Etats indépendants et jaloux les uns des autres, où tout homme libre s’est accoutumé aux armes et prétend à la gloire des exploits militaires, où le jeune homme qui depuis son enfance a manié l’arc et la lance ne désire rien tant que d’avoir une occasion de montrer sa valeur, les guerres doivent souvent résulter de provocation très frivoles. Lorsqu’une nation est plus puissante qu’une autre, elle trouve bientôt un prétexte pour commencer des hostili-tés. C’est ainsi que la guerre qui eut lieu entre le Kajaaga et le Kasson fut occa-sionnée par le refus de rendre un esclave, et celle que se firent le Bambara et le Kaarta par la perte de quelques pièces de bétail. Sans cesse il se présente d’autres causes de la même nature, dont la sottise ou l’ambition des princes profite pour mettre en jeu la faux de la désolation.
Il y a en Afrique deux espèces de guerres, que l’on distingue par deux noms différents : celle qui a le plus de rapport avec nos guerres européennes s’appelle killi, d’un mot qui signifie « appeler dehors », parce qu’elle est pour l’ordinaire ouverte et déclarée. Cette sorte de guerre, en Afrique, se termine ordinairement dans le cours d’une seule campagne. On donne une bataille ; le vaincu ne cherche guère à se rallier tous les habitants sont frappés d’une terreur panique ; il ne reste aux vainqueurs d’autre soin à prendre que celui d’attacher les prisonniers et d’emporter le butin. S’il y a des captifs qui par leur âge, leurs infirmités, ne puis-sent supporter la fatigue, ou ne soient pas susceptibles d’être vendus, on les re-garde comme inutiles ; et je ne doute point que souvent on ne les tue. Le même sort attend pour l’ordinaire tout chef, ou toute autre personne qui a joué dans la guerre un rôle très marquant. Ici je dois remarquer que, malgré ce système exter-minateur, on est surpris de voir avec quelle promptitude se reconstruit et se repeuple une ville africaine que la guerre a détruite. La cause en est probablement que les batailles meurtrières sont très rares ; le plus faible sent sa position et cherche son salut dans la fuite. Quand le pays désolé et les villes pillées sont abandonnées par l’ennemi, ceux des habitants qui ont échappé à la mort et à l’esclavage retournent avec précaution dans leur demeure primitive, car ce semble être un sentiment naturel à tous les hommes que le désir de passer le soir de sa vie aux lieux qui en ont vu l’aurore. Le pauvre Nègre éprouve avec force ce penchant ; pour lui, nulle eau n’est aussi douce que celle de son puits ; nul arbre ne répand une ombre aussi fraîche, ni sous laquelle il aime tant à se reposer que le tabba (Grand arbre dont les branches sont horizontales (espèce de sterculia), sous lequel on place ordinairement le bentang) de son village.
L’autre genre de guerre que se font les Africains s’appelle tegria (pillage ou vol). Celle-ci a pour cause des querelles héréditaires, que les habitants d’un pays ou d’un district nourrissent les uns contre les autres. Les hostilités n’ont aucune raison déterminée, et l’on ne donne aucun avis de l’attaque. Ceux qu’animent ces dissensions épient toutes les occasions de nuire aux objets de leur haine, par des pillages et des surprises. Ces incursions sont très fréquentes, surtout vers le commencement de la saison sèche. Quand le travail de la moisson est fini, et que les denrées sont communes et à bon marché, c’est alors que l’on médite des projets de vengeance ; le chef observe le nombre et l’ardeur de ses vassaux ; il les regarde brandir leurs lances dans les fêtes publiques ; glorieux de sa puissance, il tourne toutes ses réflexions vers la représaille de quelque insulte que lui ou ses ancêtres ont reçue d’un Etat voisin.
Ces sortes d’expéditions se conduisent ordinairement avec un grand secret. Un petit nombre d’hommes déterminés, commandés par quelque chef courageux et intelligent, marche en silence au travers des bois, surprend pendant la nuit quelque village sans défense et enlève les habitants et leurs effets avant que leurs voisins puissent venir à leur secours.
Un matin, pendant mon séjour à Kamalia, nous fûmes tous forts épouvantés par une troupe de cette espèce. Le fils du roi de Fouladou, avec 500 cavaliers, passa secrètement à travers les bois, un peu au sud de Kamalia, et le lendemain matin pilla 3 villes appartenantes à Madigai, chef puissant dans le Jallonkadou.
Le succès de cette attaque encouragea le gouverneur de Bangassi à faire une seconde invasion sur une autre partie du même pays. Ayant rassemblé environ 200 hommes, il passa dans la nuit la rivière Kokoro et emmena un grand nombre de prisonniers. Plusieurs des habitants qui avaient échappé à ces irruptions furent en-suite pris par les Mandingues en errant dans les bois ou en se cachant dans les val-lées et les lieux escarpés des montagnes.
Ces coups de main sont bientôt suivis de représailles. Lorsqu’on ne peut ras-sembler à cet effet beaucoup d’hommes, quelques amis se réunissent et pénètrent dans le pays ennemi, avec le projet de piller ou d’enlever des habitants. On a vu un seul homme prendre son arc et son carquois, et se hasarder ainsi. Une pareille entreprise est sans doute en ce cas un acte de folie. Mais, lorsqu’on observe que, dans quelque excursion pareille, on a peut-être enlevé à cet homme son enfant, ou ses plus proches parents, on est porté à le plaindre plutôt qu’à le blâmer. L’infortuné, poussé par le ressentiment de l’amour paternel ou de quelque autre affection domestique, animé du désir de la vengeance, se cache dans un buisson jusqu’à ce qu’il voie passer près de lui quelque enfant, ou quelque autre personne sans arme : comme un tigre, il s’élance sur sa proie, l’entraîne dans le bois, et dans la nuit l’emmène pour en faire son esclave.
Lorsqu’un Nègre, par un de ces moyens, est tombé entre les mains de ses ennemis, il reste esclave de son vainqueur, qui le garde près de lui, ou l’envoie pour être vendu dans quelque contrée éloignée. Un Africain lorsqu’il a une fois vaincu son ennemi, lui fournit rarement l’occasion de reprendre à l’avenir les armes contre lui. Le conquérant dispose ordinairement de ses esclaves d’après l’état qu’ils avaient dans leur pays natal. Ceux des domestiques qui lui semblent doux, particu-lièrement les jeunes femmes, restent à son service. Ceux qui paraissent mécontents sont envoyés au loin ; quant à ceux des hommes libres ou des esclaves qui ont pris une part active à la guerre, ils sont vendus aux slatées ou mis à mort. La guerre est donc la plus générale comme la plus féconde des causes de l’esclavage, et les dé-sastres qu’elle entraîne produisent souvent (quoique non toujours) la seconde cause de la servitude, la famine, cas dans lequel un homme libre embrasse l’esclavage pour éviter un plus grand malheur.
Aux yeux d’un philosophe, la mort semblerait peut-être un moindre mal que la perte de la liberté, mais le pauvre Nègre qu’a exténué le besoin pense comme Esaü : « Je suis sur le point de mourir, de quoi me servira mon droit d’aînesse ? » Il y a plusieurs exemples d’hommes libres qui ont renoncé volontairement à leur liberté pour sauver leur vie. Pendant une grande disette qui dura près de trois ans dans les pays voisins de la Gambie, beaucoup de gens devinrent esclaves de cette manière. Le docteur Laidley m’a assuré qu’à cette époque nombre d’hommes libres étaient venus le trouver, le suppliant de les mettre à la chaîne de ses esclaves pour les empêcher de mourir de faim. De grandes familles sont souvent exposées au besoin le plus absolu, et, comme les parents ont sur leurs enfants une autorité presque illimitée, il arrive souvent dans toutes les parties de l’Afrique que l’on vende quelques-uns de ceux-ci afin d’acheter des vivres pour le reste de la famille. Lorsque j’étais à Jarra, Daman Jumma me montra trois jeunes esclaves qu’il avait achetés de cette manière. J’ai rapporté plus haut un autre exemple dont j’avais été témoin à Wonda, et j’appris qu’alors dans le Foudalou c’était un usage très commun.
La troisième cause de servitude est l’insolvabilité. De tous les délits auxquels les lois de l’Afrique ont attaché la peine de l’esclavage, celui-ci, si l’on peut lui donner ce nom, est le plus fréquent. Un marchand nègre contracte ordinairement des dettes relativement à quelque spéculation de commerce soit avec ses voisins pour des denrées qu’il espère vendre avec avantage dans un marché éloigné, soit avec des Européens qui font la traite sur la côte, pour des articles qu’il promet de payer dans un temps donné. Dans les deux cas, la situation du spéculateur est ab-solument la même. S’il réussit, il peut s’assurer une indépendance ; s’il est malheu-reux, sa personne et ses services sont à la disposition d’un autre ; car en Afrique non seulement les effets d’un homme insolvable, mais aussi sa personne sont vendus pour satisfaire aux légitimes réclamations de ses créanciers (Lorsqu’un Nègre prend à crédit des marchandises des Européens de la côte et qu’il ne paye pas au temps convenu, le créancier a droit, suivant les lois du pays, de saisir le débiteur ou, s’il ne peut pas le trouver, quelqu’un de sa famille, ou enfin, en dernier recours, quelqu’un du même royaume. La personne ainsi saisie est retenue pendant qu’on envoie ses amis à la recherche du débiteur. Lorsqu’on a trouvé celui-ci, on convoque une assemblée des chefs du lieu, et le débiteur est forcé, en payant sa dette, de dégager son parent. S’il ne peut le faire, on se saisit sur-le-champ de sa personne : il est envoyé à la côte, et l’on remet l’autre en liberté. Si l’on ne trouve pas le débiteur, la personne arrêtée est obligée de payer le double du montant de la dette, ou elle-même est vendue comme esclave. On m’a donné lieu de croire, cependant, que cette partie de la loi était rarement exécutée.).
La quatrième cause indiquée est d’avoir commis des crimes auxquels les lois du pays attachent l’esclavage comme peine. En Afrique, les seuls crimes de cette espèce sont, outre l’insolvabilité, le meurtre, l’adultère et la sorcellerie. J’ajoute, avec plaisir, qu’ils ne m’ont pas paru être communs. On m’a assuré qu’en cas de meurtre le plus proche parent du mort avait la faculté, après la condamnation du coupable, de tuer celui-ci de sa main, ou de le vendre comme esclave. Quand il s’agit d’adultère, l’offensé a généralement le choix de vendre le coupable ou de lui faire payer une rançon qu’il estime équivalente à l’injure reçue. On entend par sor-cellerie une prétendue magie par laquelle on attente à la vie ou à la santé des gens ; en d’autres mots, c’est l’empoisonnement. Cependant, je n’ai vu juger aucun délit de cette dernière espèce pendant que j’étais en Afrique ; et je suppose que le crime, ainsi que sa punition, arrivent très rarement.
Lorsqu’un homme libre est devenu esclave par une de ces causes, il reste ordi-nairement tel pendant toute sa vie, et ses enfants, s’ils sont nés d’une mère es-clave, sont destinés à la même servitude. Il y a cependant des exemples d’esclaves qui obtiennent la liberté du consentement de leur maître ; comme pour avoir rendu quelque important service, pour aller à une bataille, ou en donnant, par forme de rançon, deux esclaves ; mais c’est en s’échappant qu’ils recouvrent le plus ordinai-rement leur liberté. Lorsqu’une fois un esclave a résolu de s’enfuir, il y réussit. Quelques-uns attendent des années entières que l’occasion s’en présente, et pen-dant ce temps ils ne donnent pas le moindre signe de mécontentement. En général, on remarque que les esclaves qui sont nés dans les montagnes, et qui ont été accoutumés à la chasse et aux voyages, sont plus disposés à s’évader que ceux qui, étant nés dans un pays plat, ont été occupés à la culture de la terre.
Tels sont les principaux traits de ce système d’esclavage qui domine en Afrique ; sa nature, son étendue prouvent que ce n’est pas une institution mo-derne. Son origine remonte probablement aux temps les plus anciens, et précède celui où les mahométans se frayèrent un chemin au travers du désert. Jusqu’à quel point est-il maintenu et encouragé par le commerce d’esclaves que font, depuis 200 ans, les peuples européens avec les naturels de la côte, c’est ce qu’il ne m’appartient pas d’examiner. Si l’on me demandait ce que je pense de l’influence qu’une discontinuation de ce commerce produirait sur les mœurs de l’Afrique, je n’hésiterais point à dire que, dans l’état d’ignorance où vivent ses habitants, l’effet de cette mesure ne serait, selon moi, ni si avantageux ni si considérable que plu-sieurs gens de bien aiment à se le persuader.