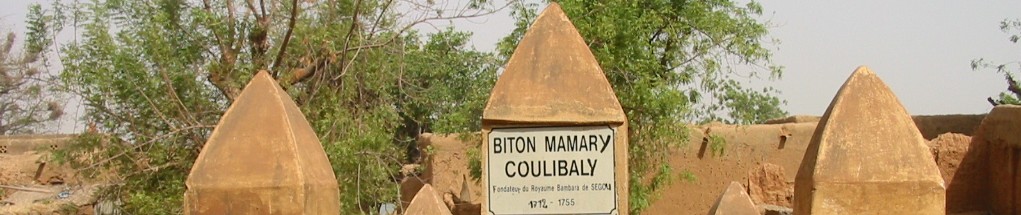A deux milles à l’est de cette rivière, nous trouvâmes une grande ville, appelée Madina, dans laquelle nous passâmes sans nous arrêter, et à deux heures après midi nous découvrîmes la ville de Jumbo, patrie du forgeron, qui en était absent depuis plus de quatre ans. Son frère avait été informé de son retour par quelque voyageur, et bientôt nous le vîmes venir à sa rencontre, accompagné d’un chanteur. Il menait un cheval de forgeron, afin qu’il entrât dans sa ville natale d’une manière un peu distinguée, et il nous pria tous de mettre une bonne charge de poudre dans nos fusils.
En nous avançant vers Jumbo, le chanteur marchait le premier, suivi des deux frères. Nous ne tardâmes pas à être joints par beaucoup de gens de la ville, qui par leurs chants et par leurs gambades témoignaient la joie qu’ils avaient de revoir leur compatriote. Quand nous entrâmes dans la ville, le chanteur improvisa une chanson à la louange du forgeron. Il vanta le courage qu’il avait montré en surmontant beaucoup de difficultés, et il conclut par inviter tous les amis de celui qu’il célébrait à lui préparer un repas abondant.
Lorsque nous fûmes rendus devant la maison du forgeron, nous mîmes pied à terre et nous fîmes une décharge de nos fusils. L’accueil que ce Nègre reçut de tous ses parents fut très tendre, et il montra lui-même beaucoup de sensibilité, car ces naïfs enfants de la nature ne savent pas se contraindre et se livrent à leurs émotions de la manière la plus forte et la plus expressive. Au milieu de tous ces transports, on conduisit la mère du forgeron, qui était aveugle, très vieille, et marchait appuyée sur un bâton. Tout le monde se rangea pour lui faire place. Elle étendit sa main sur le forgeron, en le félicitant de son retour. Ensuite elle toucha avec soin ses mains, ses bras, son visage. Elle paraissait enchantée de ce que sa vieillesse était consolée par la présence de ce fils chéri, et de ce que son oreille pouvait encore entendre sa voix.
Cette scène touchante me convainquit pleinement que, quelle que soit la différence qui existe entre le Nègre et l’Européen dans la conformation de leurs traits et dans la couleur de leur peau, il n’y en a aucune dans les douces affections et les sentiments que la nature leur inspire à l’un et à l’autre.
Pendant les premiers moments de la tumultueuse entrevue du forgeron et de ses parents, je m’assis à côté d’une chaumière, parce que je ne voulais pas les interrompre. Je crois d’ailleurs que le forgeron captivait tellement l’attention des spectateurs qu’aucun d’eux ne me remarqua. Au bout de quelque temps ils s’assirent tous. Le forgeron fut engagé par son père à faire le récit abrégé de ses aventures. Aussitôt tout le monde garda le silence, et le forgeron prit la parole.
Après avoir plusieurs fois remercié Dieu des succès qu’il avait eus dans son voyage, il fit le tableau de ce qui lui était arrivé en se rendant du royaume de Kasson dans celui de Gambie, de ses occupations et de ses avantages à Pisania, et enfin des dangers auxquels il avait échappé en retournant dans sa patrie. Dans la dernière partie de son récit, il eut souvent occasion de faire mention de moi, et, après s’être servi de plusieurs expressions très fortes pour peindre ma bienveillance envers lui, il montra l’endroit où j’étais, et s’écria : « Affilie ibi siring », ce qui signifie : « Voyez-le là assis. »
A l’instant tous les yeux furent tournés sur moi. Il semblait que je venais de tomber du sein des nuages. Tous les spectateurs étaient surpris de ne m’avoir pas plutôt aperçu, et quelques femmes et quelques enfants montrèrent beaucoup d’inquiétude en se trouvant si près d’un homme dont les traits et la couleur étaient si extraordinaires pour eux. Cependant peu à peu leurs terreurs diminuèrent, et quand le forgeron leur eut assuré que je n’étais point méchant et que je ne leur ferais point de mal quelques-uns se hasardèrent jusqu’à venir examiner mes vêtements. Beaucoup d’autres n’étaient pas tout à fait sans défiance. Sitôt que je me remuais, ou que je regardais des enfants, leurs mères se hâtaient de les emporter loin de moi. Ce ne fut qu’au bout de quelques heures qu’on s’accoutuma à ne pas me craindre.