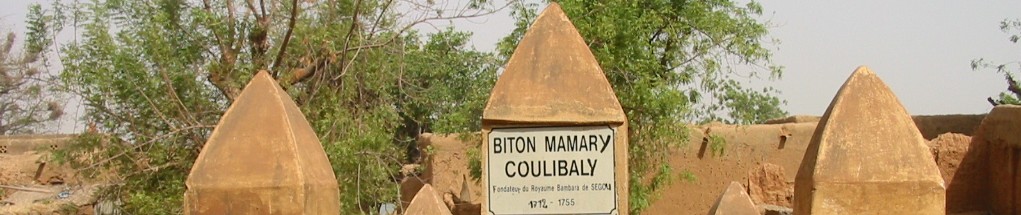Ivoire
Après avoir exposé tous les renseignements que ma mémoire a pu me fournir sur la manière dont les Africains retirent l’or de la terre et sur la valeur qu’ils lui donnent dans leurs échanges, je passe à l’autre article dont j’ai promis de parler, l’ivoire.
Rien n’étonne plus les Nègres de la côte que l’empressement avec lequel les marchands européens cherchent à se procurer des dents d’éléphant. On a beaucoup de peine à leur faire comprendre l’usage que nous en faisons. Quoiqu’on leur montre des couteaux à manche d’ivoire, des peignes et d’autres petits objets faits de cette matière, et qu’ils soient convaincus que l’ivoire ainsi manufacturé faisait dans l’origine partie d’une dent, ils ne sont pas satisfaits. Ils soupçonnent que cette matière se convertit en Europe en objets beaucoup plus importants, qu’on leur cache avec soin, de peur qu’ils n’augmentent le prix de l’ivoire. Ils ne peuvent se persuader, disent-ils, que l’on construise des vaisseaux, et que l’on entreprenne des voyages pour se procurer un article qui ne serait bon qu’à faire des manches de couteaux, etc., usages auxquels des morceaux de bois seraient tout aussi propres que de l’ivoire.
Les éléphants sont très nombreux dans l’intérieur de l’Afrique ; mais ils semblent être d’une autre espèce que ceux que l’on trouve en Asie. Blumenbach, dans ses figures d’objets d’histoire naturelle, a donné de bons dessins d’une molaire de chacune des deux espèces. M. Cuvier a donné aussi dans le magasin encyclopédique une notice très claire de leurs différences. Comme je n’ai jamais vu l’éléphant d’Asie, j’ai mieux aimé m’en rapporter à ces écrivains que d’avancer ce fait d’après mon opinion particulière. On a dit que l’éléphant d’Afrique était d’un naturel moins docile que celui d’Asie, et qu’il n’était pas susceptible d’être apprivoisé. Il est certain que les Nègres, aujourd’hui, ne les apprivoisent pas ; mais, si nous considérons que les Carthaginois avaient toujours dans leurs armées des éléphants familiarisés, et que même ils en ont transporté quelques-uns en Italie dans le temps des guerres puniques, il semble plus facile d’apprivoiser leurs propres éléphants que de supposer qu’ils se soumissent à la dépense de faire venir à grands frais de l’Asie de si énormes animaux. Peut-être l’usage barbare de chasser les éléphants pour avoir leurs dents les a-t-il rendus plus farouches et moins faciles à traiter qu’ils n’étaient dans les premiers temps.
La plus grande partie de l’ivoire que l’on vend sur les rivières de Gambie et du Sénégal y vient des pays intérieurs. Les terres voisines de la côte sont trop marécageuses, trop entrecoupées de ruisseaux et de rivières pour qu’un animal aussi gros que l’éléphant traverse librement ces contrées sans être aperçu ; or, sitôt que les naturels ont vu sur la terre une empreinte de ses pieds, tout le village prend les armes. L’espoir de manger sa chair, de faire des sandales de sa peau et de vendre ses dents aux Européens inspire à chacun du courage, et rarement l’animal échappe à ses ennemis. Mais, dans les plaines du Bambara et du Kaarta, et dans les vastes solitudes du Jallonkadou, les éléphants sont très nombreux ; et, comme la poudre à canon est fort rare dans ces contrées, les naturels ont moins de moyens de leur nuire.
On trouve souvent dans les bois des dents éparses, que les voyageurs sont très attentifs à chercher. L’éléphant a pour habitude d’enfoncer ses dents sous la racine des arbustes et des buissons qui croissent dans les parties hautes et sèches du pays, où le sol est léger et peu profond. Il renverse aisément ces arbustes, et se nourrit des racines qui sont en général plus tendres et plus remplies de suc que ne le sont le bois sec des branches, et même les feuilles. Mais, lorsque les dents sont en partie cariées par l’âge, et que l’arbre ne cède pas, les grands efforts de l’animal les font quelquefois casser net. Je vis à Kamalia deux dents, dont une était fort grande, qui avaient été trouvées dans les bois et qui évidemment avaient été rompues de cette manière. Il serait au reste difficile d’expliquer autrement la grande quantité d’ivoire en morceaux qu’on apporte à vendre aux différentes factoreries ; car, lorsqu’un éléphant a été tué à la chasse, ses dents, à moins qu’il ne les ait brisées en se jetant dans quelque précipice, sont toujours retirées entières [1].
Il y a de certains temps de l’année où les éléphants se rassemblent en grands troupeaux, et traversent le pays pour aller chercher ou de l’eau ou des aliments ; et, comme toute la contrée qui est au nord du Niger est dépourvue de rivières, lorsque les mares des bois sont desséchées, les éléphants s’approchent des bords de ce fleuve. Ils y restent jusqu’au commencement de la saison pluvieuse, vers les mois de juin ou de juillet ; et pendant ces intervalles ils sont beaucoup chassés par les habitants du Bambara, qui ont de la poudre à perdre. Les chasseurs d’éléphants sortent rarement seuls : ils se réunissent quatre ou cinq. Chacun se pourvoit de poudre, de balles, et prend dans un sac de cuir assez de farine de maïs pour servir à sa consommation pendant cinq ou six jours. Ils entrent ainsi dans les parties les moins fréquentées des forêts, et examinent avec grand soin tout ce qui peut les conduire à la découverte des éléphants. Quoique l’animal soit fort gros, cette recherche demande beaucoup d’attention. Les branches rompues, les fientes éparses de l’éléphant, les empreintes de ses pieds sont observées attentivement de plusieurs chasseurs ; à force d’exercice et d’observation, ils ont acquis dans cet art tant de sagacité qu’aussitôt qu’ils ont vu le pas d’un éléphant ils vous disent, avec une espèce de certitude, combien il y a de temps qu’il a passé et à quelle distance on doit le trouver.
S’ils rencontrent une troupe d’éléphants, ils la suivent de loin jusqu’à ce qu’ils en voient quelqu’un s’éloigner des autres et venir dans une position où ils puissent le tirer avec avantage. Ils s’approchent, en ce cas, avec beaucoup de précaution, rampant entre les herbes, jusqu’à ce qu’ils soient assez près pour être sûrs de leur coup. Ils tirent alors tous leur coup à la fois, et se jettent dans l’herbe la face contre terre. L’éléphant blessé va sur le champ se frotter contre différents arbres ; mais, ne pouvant arracher les balles, et ne voyant personne sur qui se venger, il devient furieux et se met à courir à travers les broussailles, jusqu’à ce qu’épuisé par la fatigue et la perte de son sang il donne aux chasseurs occasion de faire sur lui une seconde décharge, qui ordinairement l’abat.
On enlève alors la peau, qu’on étend par terre, en l’assujettissant avec des chevilles pour la faire sécher. On coupe les morceaux de chair les plus estimés, en tranches minces que l’on fait sécher au soleil pour s’en servir dans l’occasion. On enlève les dents avec une petite hache que les chasseurs portent toujours avec eux, non seulement pour cet usage, mais aussi pour pouvoir couper les arbres qui renferment du miel ; car, quoiqu’ils n’emportent des provisions que pour cinq ou six jours, si leur chasse est heureuse, ils restent quelquefois des mois entiers dans la forêt. Ils se nourrissent, pendant ce temps-là, de chair d’éléphant et de miel sauvage.
L’ivoire que procurent ces chasses est rarement apporté à la côte par les chasseurs eux-mêmes. Ils le vendent à des marchands ambulants, qui viennent annuellement de la côte avec des armes et des munitions pour acheter cette précieuse marchandise. Quelques-uns de ces marchands ramassent, dans le cours d’une saison, assez d’ivoire pour charger quatre ou cinq ânes. Il vient aussi de l’intérieur une grande quantité d’ivoire qu’apportent les troupes d’esclaves. Cependant, il se trouve des slatées mahométans qui, par principes de religion, ne veulent pas traiter de l’ivoire, ni manger de la chair d’éléphant, à moins que l’animal n’ait été tué à coups de lance.
Il ne se ramasse pas, dans cette partie de l’Afrique, autant d’ivoire, et les dents n’y sont pas aussi grosses que dans les contrées les plus voisines de la ligne. Peu pèsent ici plus de quatre-vingts ou cent livres ; et, l’une dans l’autre, une barre de marchandises européennes peut être regardée comme le prix d’une livre d’ivoire.