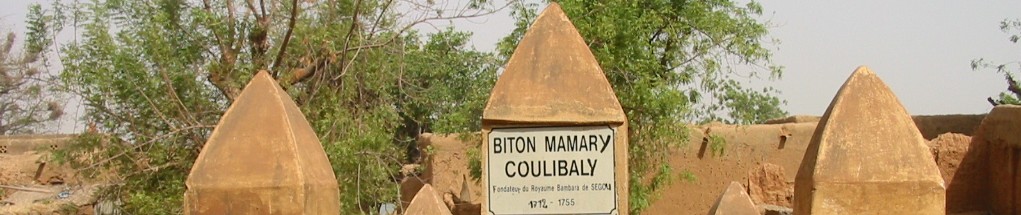IX Description de Jarra et des Maures qui l’habitent. — M. Mungo Park obtient d’Ali, roi de Ludamar, la permission de traverser ses Etats. — Il se rend de Jarra à Deena. — Il est maltraité par les Maures. — Arrivée à Sampaka. — Nègre qui fait de la poudre à feu. — M. Mungo Park poursuit sa route jusqu’à Samée, où il est arrêté par les ordres d’Ali. — On le mène prisonnier jusqu’au camp des Maures, à l’entrée du grand désert.
La ville de Jarra est très grande, ses maisons sont bâties en pierre et en argile, c’est-à-dire que l’argile y sert de mortier. Cette ville est située dans le royaume maure de Ludamar, mais la plupart de ses habitants sont des Nègres qui sortent des Etats du Midi et préfèrent de payer un tribut aux Maures pour obtenir leur incertaine protection que de rester exposés chez eux à leurs agressions et à leurs rapines.
Le tribut qu’ils paient est considérable ; ils sont d’ailleurs obligés de montrer aux Maures un profond respect et une obéissance illimitée, tandis que ces tyrans orgueilleux les traitent avec non moins de dureté que de mépris.
Les Maures du Ludamar et des autres royaumes limitrophes de la Négritie ressemblent tellement aux mulâtres des Antilles et des autres parties de l’Amérique qu’il n’est pas possible d’en faire la différence ; aussi est-il certain qu’ils sont un mélange des Maures du nord de l’Afrique et des Nègres du Midi, et qu’ils possèdent les plus mauvaises qualités des deux races dont ils descendent.
Ces tribus maures se distinguent des habitants des côtes de Barbarie, dont elles sont séparées par le grand désert. Tout ce qu’on sait sur leur origine se trouve dans Léon l’Africain. Je vais abréger ici ce qu’il en dit.
Vers le milieu du VIIe siècle, lorsque les Arabes n’avaient point encore conquis l’Afrique, tous les habitants de cette partie du monde, soit qu’ils descendissent des Numides, des Phéniciens, des Carthaginois, soit qu’ils fussent issus des Romains, des Goths et des Vandales, étaient compris sous la dénomination générale de Maures.
Tandis que les kalifes étendaient l’empire de l’islamisme, presque toutes ces nations embrassèrent cette religion. Cependant, quelques tribus numides qui erraient dans les déserts et vivaient du produit de leurs troupeaux traversèrent ces déserts immenses pour se dérober à la fureur des Arabes. L’une de ces tribus, celle de Zanhaga, fit la découverte et la conquête des nations à la peau noire et aux cheveux laineux qui habitent le long du Niger.
Par le nom de Niger, Léon a voulu indubitablement désigner le Sénégal, qui dans la langue des Mandingues est appelé Bafing, c’est-à-dire le fleuve Noir.
Il est difficile de dire tout ce que ces Maures occupent aujourd’hui dans le continent d’Afrique. Mais il y a lieu de croire que les pays soumis à leur domination forment une bande étroite qui s’étend de l’ouest à l’est, depuis l’embouchure du Sénégal [2] jusqu’aux confins de l’Abyssinie. C’est un peuple perfide et rusé ; il ne laisse jamais échapper l’occasion de tromper et de voler les naïfs et crédules Nègres. Mais je ferai connaître d’une manière plus détaillée ses mœurs et ses habitudes, en reprenant le fil de ma narration.
A mon arrivée à Jarra, je logeai dans la maison de Daman Jumma, slatée qui faisait le commerce de Gambie. Daman Jumma avait depuis longtemps acheté des marchandises à crédit, chez le docteur Laidley, qui à mon départ de Pisania me donna un ordre pour en recevoir le montant jusqu’à la valeur de six esclaves. Quoiqu’il y eût cinq ans que les marchandises fussent vendues, Daman Jumma ne nia point sa dette ; il me promit au contraire de me donner tout l’argent qu’il pourrait se procurer, quoique, me dit-il, il craignait bien que dans ce moment il ne pût me compter plus de la valeur de deux esclaves. Il s’employa avec honnêteté à échanger mon ambre et mes grains de verroterie pour de l’or, chose plus portative et plus facile à soustraire à la rapacité des Maures.
Les difficultés que j’avais déjà éprouvées, l’état incertain du pays et surtout la sauvage et oppressive conduite des Maures avaient tellement effrayé mes domestiques qu’ils me déclarèrent qu’ils préféraient renoncer à toute récompense que de faire un pas de plus du côté de l’est. A la vérité, le danger d’être pris par les Maures et vendus comme esclaves devenait chaque jour plus éminent pour eux, et je ne pouvais pas blâmer leurs craintes. Me voyant donc sur le point d’être abandonné par mes gens, et réfléchissant que la guerre du Kaarta m’empêchait de retourner sur mes pas et que pour aller plus loin il me fallait traverser un pays maure de dix journées de marche, je m’adressai à Daman pour obtenir d’Ali, souverain du Ludamar, la permission de passer dans ses Etats sans y recevoir d’insultes, afin de me rendre dans le Bambara. Je louai un esclave de Daman pour m’accompagner jusque-là, me proposant de me mettre en route dès que j’aurais obtenu la permission d’Ali.
Daman fit partir un messager pour aller demander cette permission à Ali, qui était alors occupé près de Benowm ; et comme un présent était nécessaire pour assurer le succès de la négociation j’échangeai avec Daman un de mes fusils de chasse pour cinq vêtements de toile de coton, et je les envoyai à Ali. Quatorze jours s’écoulèrent avant que l’affaire fût conclue avec Ali, mais dès le 26 février un des esclaves de ce prince arriva à Jarra et vint me dire qu’il était chargé par son maître de me conduire en sûreté jusqu’à Goumba, prétendant en même temps qu’il fallait que je lui donnasse pour sa peine un vêtement de toile de coton.
Mon fidèle domestique, Demba, me voyant prêt à poursuivre mon voyage sans lui, résolut de m’accompagner. Il me dit que, bien qu’il désirât que je n’allasse pas plus loin, il n’avait jamais eu l’intention de me quitter ; que, d’après le conseil de Johnson, il avait seulement voulu me le faire craindre pour m’engager à retourner immédiatement sur les bords de la Gambie.
Le 27 février, je remis la plupart de mes papiers à Johnson, en lui recommandant de les porter le plus promptement possible à Pisania. J’en gardai pourtant un duplicata, pour qu’en cas d’accident ce qu’ils contenaient ne fût pas perdu. Je laissai aussi chez Daman un paquet de hardes et toutes les choses qui ne m’étaient pas absolument nécessaires, car je voulais diminuer mon bagage le plus qu’il était possible, afin que les Maures fussent moins tentés de me piller.
Après ces arrangements, je partis l’après-midi de Jarra avec l’esclave d’Ali, celui de Daman et mon domestique. Nous couchâmes à Troumgoumba, petit village habité en partie par des Maures et en partie par des Nègres. Le lendemain nous arrivâmes à Quira. Le jour suivant nous traversâmes un pays rempli de sables, dans lesquels nous marchions avec beaucoup de peine, et nous fîmes halte à Compe, lieu où l’on trouve de l’eau, et qui appartient aux Maures.
Le 1er mars, nous nous rendîmes à Deena, grande ville, bâtie, comme Jarra, de pierre et d’argile. On y trouve beaucoup plus de Maures et moins de Nègres qu’à Jarra. Ils se rassemblèrent autour de la chaumière du Nègre chez qui je logeais et me traitèrent avec la plus grande insolence. Ils sifflaient, huaient et m’accablaient d’injures. Ils me crachèrent même au visage, dans l’espoir de m’irriter et d’avoir un prétexte pour s’emparer de mon bagage. Quand ils s’aperçurent que tous ces outrages ne faisaient pas sur moi l’effet qu’ils en attendaient, ils eurent recours à un moyen plus décisif. Ils dirent que j’étais un chrétien, et que par conséquent tous les enfants de Mahomet avaient droit de piller ce qui m’appartenait. En conséquence, ils ouvrirent mes paquets et prirent tout ce qui était à leur gré. Mes gens, voyant que tout le monde pouvait nous voler impunément, me dirent qu’il fallait absolument retourner à Jarra.
Le 2 mars, j’employai tous les moyens qui étaient en mon pouvoir pour engager mes guides et mon domestique à continuer notre voyage, mais ils persistèrent dans leur refus. Comme j’avais tout lieu de craindre quelque nouvelle insulte de la part des fanatiques maures de Deena, je résolus de poursuivre ma route tout seul. Je partis donc le lendemain à deux heures du matin. Il faisait clair de lune, mais les hurlements des bêtes féroces m’obligeaient à voyager avec précaution.
A peine étais-je rendu sur une petite colline, à un demi-mille de la ville, que j’entendis crier derrière moi. Je me retournai, et je vis mon fidèle Demba qui courait après moi. Il m’apprit que l’esclave d’Ali s’en allait à Benowm et que l’esclave de Daman était prêt à repartir pour Jarra. Mais, ajouta-t-il, si vous voulez attendre un peu, je ne doute pas que je ne détermine le dernier à vous accompagner. J’attendis comme il le désirait, et au bout d’une demi-heure je le vis revenir avec l’esclave.
Nous traversâmes un pays sablonneux, couvert de grands asclépias ; vers midi, nous trouvâmes plusieurs chaumières abandonnées. Comme je vis qu’il devait y avoir de l’eau à peu de distance, je chargeai mon Nègre de tâcher d’en remplir un soufrou. Il partit aussitôt pour y aller, mais, tandis qu’il cherchait l’endroit où était l’eau, le rugissement d’un lion qui la cherchait aussi sans doute lui fit tant de peur qu’il s’en revint à la hâte, et nous fûmes obligés de nous passer d’eau. L’après-midi flous arrivâmes dans une ville appelée Samamingkous, dont la plupart des habitants sont de la race des Foulahs.
Le 4 mars au matin, nous partîmes pour Sampaka, où nous fûmes rendus à deux heures après midi. Nous vîmes en route une si grande quantité de sauterelles que les arbres en étaient blancs. Ces insectes dévorent tous les végétaux qu’ils rencontrent, et il ne leur faut que très peu de temps pour dépouiller un arbre de toutes ses feuilles. Le bruit que font leurs excréments en tombant sur les feuilles et sur l’herbe sèche ressemble beaucoup à celui de la pluie. Quand on secoue un arbre sur lequel ces sauterelles sont posées, il en part aussitôt une quantité qui ressemble à un épais nuage. Elles suivent dans leur vol la direction du vent qui dans la saison du sec souffle toujours du nord-est. Si le vent changeait, on ne conçoit pas comment elles feraient pour se nourrir, car tous les endroits où elles ont passé sont absolument dévastés.
Sampaka est une grande ville. Lorsque les Maures et les Bambaras étaient en guerre, les premiers l’attaquèrent trois fois et furent toujours repoussés avec beaucoup de perte. Cependant, pour obtenir la paix, le roi de Bambara fut obligé de leur céder cette ville, ainsi que toutes les autres qui sont entre elle et Goumba.
A Sampaka, je logeai dans la maison d’un Nègre qui faisait de la poudre à feu. Il me montra un sac de salpêtre fort blanc, mais dont les cristaux étaient plus petits qu’ils ne le sont ordinairement. On en tire une grande quantité des étangs, qui sont remplis dans la saison des pluies, et où pendant le temps du sec le bétail cherche à éviter les grandes chaleurs. Quand l’eau est évaporée, on voit sur le limon une croûte blanchâtre, que les gens du pays ramassent et qu’ils purifient de manière à pouvoir l’employer avec succès. Les Maures leur fournissent du soufre qui vient des ports de la Méditerranée. Les Nègres font de la poudre en pilant ensemble dans un mortier de bois les différentes matières qui doivent la composer ; les grains en sont inégaux, et le bruit que produit leur explosion n’est pas, à beaucoup près, aussi fort que celui de la poudre d’Europe.
Le 5 mars, nous quittâmes Sampaka au point du jour. Vers midi, nous fîmes halte dans le village de Dangali, et le soir nous arrivâmes à Dalli, où nous passâmes la nuit. Nous vîmes en route deux grands troupeaux de chameaux qui paissaient. Quand les Maures font paître leurs chameaux, ils leur relèvent une des jambes de devant et l’attachent pour empêcher qu’ils ne s’éloignent.
Le jour que nous arrivâmes à Dalli était un jour de fête. Les habitants dansaient devant la maison du douty, mais dès qu’ils apprirent qu’il y avait un homme blanc ils quittèrent la danse et vinrent dans l’endroit où je logeais, marchant deux à deux avec beaucoup d’ordre, et précédés de la musique. Les musiciens jouent d’une espèce de flûte dont ils prennent l’embouchure non sur le côté, mais sur l’une des extrémités, qui est à demi fermée par un morceau de bois. Cet instrument a divers trous, que les musiciens laissent ouverts, ou sur lesquels ils appuient les doigts pour former les différents tons. Parmi les airs que j’entendis, il y en avait de très doux et très mélancoliques.
On continua à chanter et à danser jusqu’à minuit, et pendant tout ce temps je fus environné d’une si grande foule de peuple qu’il fallut que je me tinsse assis pour satisfaire sa curiosité.
Le 6 mars, nous restâmes la moitié de la journée à Dalli, pour attendre quelques personnes qui, devant aller le lendemain à Goumba, désiraient de faire la route avec nous. Cependant, voulant éviter la foule qui a coutume de s’assembler le soir, nous nous rendîmes à Samée, petit village situé à l’est de Dalli. Le bienveillant et hospitalier douty de Samée nous reçut avec beaucoup d’honnêteté, et pour témoigner la satisfaction qu’il avait à nous voir chez lui il fit tuer deux beaux moutons et invita ses amis à être du festin qu’il nous donna.
Ce Nègre était si fier d’héberger un homme blanc qu’il me pria de rester avec lui et ses amis le lendemain pendant la chaleur du jour, me disant que le soir il me conduirait lui-même jusqu’au premier village. Comme nous n’étions plus qu’à deux journées de marche de Goumba, les craintes que m’avaient inspirées les Maures étaient dissipées, et je n’hésitai pas à accepter l’invitation de mon hôte. Je passai l’avant-midi agréablement avec ces bonnes gens. Leur société me faisait d’autant plus de plaisir que leur candeur et leur bienveillance faisaient un contraste frappant avec la perfidie et la cruauté des Maures. Ils s’égayaient en buvant de cette espèce de bière qu’on fait avec du maïs et que j’ai décrite dans le premier chapitre de cet ouvrage. Certes, je le répète, je n’en ai jamais bu de meilleure en Angleterre.
Tandis que je me réjouissais à Samée et que, me flattant d’être échappé à toute espèce de danger du côté des Maures, je me transportais en imagination sur les bords du Niger, et je me représentais les scènes ravissantes que je croyais devoir m’attendre dans l’intérieur de l’Afrique, je fus tour à tour arraché à ce rêve brillant par une troupe de soldats d’Ali qui entrèrent dans la chaumière. Ils me dirent que leur maître les avait chargés de me mener dans son camp ; que si je voulais m’y rendre de bonne grâce je n’avais rien à craindre ; mais que si je refusais de marcher leur ordre portait de m’y conduire par force.
Je restai quelque temps muet d’étonnement et de terreur. Les Maures, qui s’en aperçurent, essayèrent de m’encourager, en m’assurant de nouveau que je n’avais rien à craindre. Ils ajoutèrent qu’ils étaient venus me chercher pour complaire à Fatima, épouse d’Ali, parce que, ayant souvent entendu parler des chrétiens, elle désirait beaucoup d’en voir un, mais qu’il n’y avait point de doute qu’aussitôt que la curiosité de cette femme serait satisfaite Ali me ferait quelque présent considérable et me fournirait un guide pour me conduire dans le Bambara.
Je vis bien que les prières et la résistance seraient également inutiles ; ainsi je me déterminai à suivre les messagers d’Ali et je me séparai de mon hôte avec beaucoup de regret. L’esclave de Daman s’était sauvé dès qu’il avait aperçu les Maures, mais le fidèle Demba resta auprès de moi et ne me quitta point lorsqu’ils m’emmenèrent. Nous allâmes coucher à Dalli, où durant toute la nuit les Maures nous gardèrent avec soin.
Le 8 mars, nous suivîmes à travers les bois un sentier tortueux qui nous mena à Dangali, où nous passâmes la nuit.
Le 9 mars, nous étant mis en route dès le matin, nous arrivâmes dans l’après-midi à Sampaka. Ce jour-là nous rencontrâmes en chemin un parti de Maures bien armés qui nous dirent qu’ils étaient en cherche d’un esclave fugitif. Mais ensuite les gens de Sampaka nous apprirent que les Maures étaient venus le matin pour leur enlever du bétail et qu’ils avaient été repoussés. D’après la description qu’ils nous firent de ces brigands, nous reconnûmes que c’étaient les mêmes que nous avions vus sur la route.
Le lendemain, nous dirigeâmes nos pas vers Samamingkous. Une femme qui conduisait un âne, et qui avait avec elle deux jeunes garçons, nous apprit en route qu’elle voulait aller dans le Bambara, mais qu’ayant été arrêtée par une troupe de Maures qui lui avaient volé la plus grande partie de ses hardes et un peu d’or elle était obligée de retourner à Deena jusqu’après la lune du rhamadan. Le soir, on vit la nouvelle lune qui annonça le commencement du carême. Aussitôt on alluma de grands feux dans toutes les parties de la ville et on fit cuire beaucoup plus d’aliments que de coutume.
Le 11 mars, les Maures furent prêts à partir dès la pointe du jour. Ils m’assurèrent qu’ils ne mangeraient ni ne boiraient jusqu’à ce que le soleil fût couché. Pour moi qui, les jours précédents, avais beaucoup souffert parce que je n’avais pas pu boire en route, je recommandai à mon Nègre de prendre un soufrou d’eau pour mon usage. Cependant je ne fus pas le seul à qui cette précaution servit. L’excessive chaleur et la poussière engagèrent les Maures à vaincre leurs scrupules, et ils eurent plus d’une fois recours à mon soufrou.
En arrivant à Deena, j’allai présenter mon respect à l’un des fils d’Ali. Je le trouvai dans une chaumière très basse, avec cinq à six de ses compagnons. Ils étaient tous ensemble occupés à laver leurs pieds et leurs mains. Ils prenaient souvent de l’eau dans leur bouche, s’en gargarisaient et la rejetaient.
Je ne fus pas plutôt assis que le fils d’Ali me présenta un fusil à deux coups, en me disant d’en teindre la culasse en bleu et de raccommoder une des platines. J’eus beaucoup de peine à lui persuader que je n’entendais rien à ces choses-là. « Eh bien, me dit-il enfin, si vous ne pouvez pas raccommoder mon fusil, vous me donnerez tout de suite quelques couteaux et quelques paires de ciseaux. » Mon Nègre Demba, qui nous servait d’interprète, répondit que je n’avais ni couteaux ni ciseaux. A l’instant le fils d’Ali, saisissant une carabine qui était à côté de lui, la banda, eu appuya le bout sur l’oreille du Nègre, et lui aurait fait indubitablement sauter la cervelle si les autres Maures ne lui avaient arraché l’arme des mains, en nous faisant signe au Nègre et à moi de nous retirer.
Mon Nègre, épouvanté des risques que lui avait fait courir le fils d’Ali, tenta de s’évader la nuit suivante, mais il en fut empêché par les Maures qui, comme je l’ai déjà dit, nous veillaient de près. Ils couchaient toujours à la porte de la chaumière où nous étions renfermés, de manière qu’il était impossible de sortir sans marcher sur eux.
Le 12 mars, nous quittâmes Deena. Vers les neuf heures, nous nous arrêtâmes un moment près d’une korrée dont l’eau était tellement diminuée que les Maures, qui avaient coutume de résider à côté, étaient sur le point de s’en éloigner pour se retirer vers le Sud. Nous y remplîmes notre soufrou, et nous nous remîmes en route. Le pays que nous traversions était très sablonneux et couvert de petits halliers. La chaleur était si accablante qu’à une heure après midi nous fûmes forcés de faire halte. Mais, comme nous n’avions plus d’eau, cette halte ne put être que de quelques minutes. Pendant ce temps-là, nous ramassâmes quelques morceaux d’une gomme qui supplée en partie à l’eau, parce qu’elle humecte la bouche et calme pour quelque temps les tourments de la soif.
Vers les cinq heures, nous découvrîmes Benowm, résidence d’Ali. Son camp offrait le spectacle d’un grand nombre de tentes malpropres, semées sans ordre sur un vaste terrain, et au milieu desquelles étaient de grands troupeaux de chameaux, de bœufs et de chèvres. Nous arrivâmes à l’entrée du camp quelques moments avant le coucher du soleil, et nous eûmes beaucoup de peine à obtenir un peu d’eau.
Dès qu’on sut que j’étais là, les Maures qui puisaient de l’eau quittèrent leurs seaux ; ceux qui étaient sous les tentes montèrent à cheval, et les hommes, les femmes, les enfants accoururent sur mon passage. Je me vis bientôt environné et pressé par tant de monde qu’il m’était presque impossible de me remuer. L’un me tirait par l’habit, l’autre m’ôtait mon chapeau, un troisième m’arrêtait pour examiner les boutons de ma veste, un quatrième criait : « La Illah el Allah Mahomet rasoul Allah » Et il me disait en me menaçant qu’il fallait que je répétasse ces paroles.
Enfin nous arrivâmes à la tente du roi, devant laquelle beaucoup d’hommes et de femmes s’étaient rassemblés. Ali, assis sur un coussin de maroquin noir, était occupé à rogner quelques poils de moustache, tandis qu’une femme esclave tenait un miroir devant lui. C’était un vieillard de la race des Arabes. Il portait une longue barbe blanche, et il avait l’air sombre et de mauvaise humeur. Il me considéra très attentivement. Ensuite il demanda à mes conducteurs si je parlais la langue arabe. Ils lui répondirent que non. Il en parut très étonné, et il garda le silence. Les personnes qui étaient auprès de lui, et surtout les femmes, ne faisaient pas de même. Elles m’accablaient de questions, regardaient toutes les parties de mes vêtements, fouillaient dans mes poches, et m’obligeaient à déboutonner mon gilet pour examiner la blancheur de ma peau. Elles allèrent même jusqu’à compter les doigts de mes pieds et de mes mains, comme si elles avaient douté que j’appartinsse véritablement à l’espèce humaine.
Peu de temps après mon entrée dans la tente, un prêtre annonça la prière du soir. Mais, avant qu’on sortît pour s’y rendre, le Maure qui faisait l’office d’interprète me dit qu’Ali allait me faire donner quelque chose à manger. Je vis presque aussitôt paraître deux jeunes gens qui traînaient un cochon sauvage, qu’ils attachèrent à l’un des piquets de la tente. Ali leur fit signe de le tuer et de le préparer pour mon souper. Quoique j’eusse grand-faim, je ne crus pas prudent de manger d’un animal que les Maures ont en horreur ; c’est pourquoi je me hâtai de dire à l’interprète que je ne touchais jamais à une pareille viande.
Alors les jeunes gens détachèrent le cochon, dans l’espoir qu’il courrait sur moi, car tous les Maures s’imaginent qu’il existe une grande antipathie entre les cochons et les chrétiens, mais ils se trompèrent. L’animal ne fut pas plutôt en liberté qu’il attaqua indistinctement tous ceux qui se trouvaient sur son passage, et il alla se réfugier sous le coussin même du roi.
Les spectateurs s’étant retirés pour aller à la prière, je fus conduis vers la tente du premier esclave d’Ali, mais on ne me permit ni d’y entrer ni de toucher rien de ce qui en dépendait. Je demandai quelque chose à manger ; après m’avoir fait longtemps attendre, on m’apporta dans une gamelle un peu de maïs bouilli avec du sel et de l’eau et on étendit devant la tente une natte sur laquelle je passai la nuit, environné d’une foule de curieux.
Au lever du soleil, Ali vint devant la tente de son premier esclave. Il était à cheval et accompagné d’un petit nombre de personnes. Il me dit qu’il m’avait fait préparer une cabane où je serais à l’abri du soleil. On m’y conduisit en effet, et en la comparant avec l’endroit d’où je sortais je la trouvai très fraîche et très agréable. Cette cabane était de forme carrée et construite de tiges de maïs verticalement placées. Le toit, construit aussi de tiges de maïs, était soutenu par deux poteaux fourchus, à l’un desquels on avait attaché le cochon sauvage dont j’ai parlé plus haut. Ce cochon avait été mis près de moi par ordre d’Ali, qui voulait sans doute par là tourner les chrétiens en ridicule. J’avoue qu’un pareil voisinage me parut fort désagréable parce qu’un grand nombre d’enfants vint s’amuser à l’agacer et à le battre, mais enfin ils l’irritèrent tellement qu’il rompit sa corde, s’enfuit et mordit plusieurs personnes.
Lorsque je fus dans ma cabane, les Maures s’assemblèrent en foule pour me contempler. Leur curiosité était extrêmement incommode. Il fallait me déchausser pour leur montrer mes pieds. J’étais même obligé d’ôter ma veste et mon gilet, afin de leur faire voir comment je m’habillais et me déshabillais. Ils ne pouvaient se lasser d’admirer l’invention des boutons ; et depuis midi jusqu’au soir je ne fis autre chose qu’ôter et remettre mes habits, les boutonner et les déboutonner, car ceux qui avaient déjà vu ces merveilles insistaient pour que leurs amis jouissent du même plaisir.
A huit heures du soir, Ali m’envoya un peu de kouskous avec du sel et de l’eau pour mon souper. Ces aliments vinrent à propos, car je n’avais rien mangé depuis le matin.
Pendant la nuit, les Maures tinrent continuellement des sentinelles à ma porte. Ils entraient même de temps en temps dans ma cabane pour voir si je dormais, et quand il fit très nuit ils allumèrent des paquets de paille. Vers deux heures du matin, un homme se glissa dans ma cabane, dans l’intention de voler quelque chose, ou peut-être de m’assassiner. En tâtonnant, il mit la main sur mon épaule. Comme les gens qui rendent de pareilles visites sont au moins très suspects, je me levai avec précipitation. L’homme, dont j’avais senti la main, voulant aussitôt s’échapper, trébucha sur mon Nègre et alla tomber sur le cochon sauvage qu’on avait rattaché à ma porte et qui le mordit au bras.
Les cris que la douleur arracha à cet homme alarmèrent les gens qui gardaient la tente du roi. Ils crurent que je m’étais évadé, et plusieurs d’entre eux montèrent à cheval pour me poursuivre. Je remarquai, en cette occasion qu’Ali n’avait pas passé la nuit dans sa tente, car il sortit d’une autre petite tente très éloignée. Il montait un cheval blanc, et il vint au galop vers ma cabane. Ce tyran cruel et soupçonneux se défiait tellement de tous ceux qui l’approchaient que même les esclaves attachés à sa personne ne savaient jamais où il couchait. Quand les Maures lui eurent expliqué la cause de cette rumeur, il se retira ainsi qu’eux, et l’on me permit de reposer tranquillement jusqu’au lendemain.
Le 13 mars, la multitude revint dans ma cabane, et je fus tout aussi tracassé, tout aussi insulté que la veille. Les enfants se rassemblèrent pour battre le cochon, et les hommes et les femmes pour tourmenter le chrétien. Il m’est impossible de décrire la conduite d’un peuple qui fait une étude de la méchanceté comme d’une science, et qui se réjouit des chagrins et des infortunes des autres hommes. Il me suffit de dire que ma présence fournit aux Maures l’occasion d’exercer à leur gré l’insolence, la férocité et le fanatisme qui les distinguent du reste du genre humain. J’étais étranger, sans protection et chrétien. Chacun de ces titres suffit pour écarter du cœur d’un Maure tout sentiment d’humanité : que devait-ce donc être, les réunissant tous les trois, et étant de plus soupçonné d’être venu dans le pays comme espion ? On doit aisément croire que, dans une telle situation, j’avais tout à redouter.
Cependant, désirant de ne donner aux Maures aucun prétexte de me maltraiter, et voulant au contraire tâcher de me concilier un peu leur bienveillance, je fis tout ce qu’ils me commandèrent et supportai patiemment leurs outrages. Mais jamais le temps ne m’a paru aussi long. Depuis le moment où le soleil se levait jusqu’à celui où il se couchait, j’étais obligé de souffrir d’un air tranquille les insultes des sauvages les plus brutaux qui existent sur la terre.
X Récit de ce qui arrive à M. Mungo Park pendant qu’il est prisonnier à Benowm. — Il reçoit la visite de quelques dames maures. — Funérailles et mariages. — Présent extraordinaire que la mariée fait à M. Mungo Park. — Autres détails sur les mœurs et le caractère des Maures.
Quoique très paresseux, les Maures sont exacteurs, et ils font rigoureusement travailler tous ceux qui leur sont soumis. Ils envoyaient dans les bois mon Nègre Demba ramasser de l’herbe sèche pour les chevaux d’Ali, et après avoir cherché divers moyens de m’occuper moi-même ils me trouvèrent enfin un emploi : c’était celui de barbier. L’on voulut que je donnasse la première preuve de mon talent en présence du roi, et on me chargea de raser la tête du jeune prince de Ludamar.
Je m’assis donc sur le sable, et l’enfant s’assit devant moi avec quelque répugnance. On me mit en main un rasoir de trois pouces de long et l’on m’ordonna de commencer. Je ne sais pas si je dois en accuser ma maladresse ou la forme du rasoir, mais à peine commençais-je à me servir de cet instrument que je fis une petite incision à la tête de l’enfant. Le roi, voyant la manière dont je m’y prenais, jugea que la tête de son fils était dans des mains inhabiles. Sur-le-champ, il me fit quitter le rasoir et sortir de sa tente. Je regardai cet événement comme assez heureux pour moi, car je pensais que pour obtenir ma liberté il fallait me rendre aussi inutile, aussi insignifiant qu’il était possible.
Le 18 mars, quatre Maures amenèrent au camp d’Ali mon interprète Johnson, qui avait été arrêté à Jarra avant de savoir que j’étais prisonnier. Les Maures apportèrent en même temps un paquet de hardes que j’avais laissé chez Daman Jumma, afin de pouvoir m’en servir, si, à mon retour, je passais par Jarra.
Johnson fut conduit dans la tente d’Ali et interrogé. On ouvrit le paquet, et on m’envoya chercher pour que j’expliquasse l’usage des différentes choses qu’il contenait. J’appris alors avec plaisir que Johnson avait déposé mes papiers dans les mains d’une des femmes de Daman. Quand j’eus satisfait la curiosité d’Ali au sujet de mes hardes, le paquet fut refermé, et on le mit dans un grand sac de cuir qui était dans un coin de la tente. Le même soir, Ali envoya trois de ses gens pour me dire qu’il y avait beaucoup de voleurs dans les environs, et que pour empêcher qu’on dérobât ce qui m’appartenait il fallait le faire charrier dans sa tente. Mes hardes, mes instruments et tout ce que j’avais fut donc emporté, et quoique la chaleur et la poussière me rendissent très nécessaire le changement de linge il ne me fut pas possible de garder d’autre chemise que celle que j’avais sur le corps.
Cependant Ali fut extrêmement surpris de ne pas trouver parmi mes effets la quantité d’or et d’ambre sur laquelle il avait compté. Pour savoir si je n’en avais pas caché sur moi, il renvoya le lendemain matin ses trois émissaires, qui, avec leur brutalité accoutumée, visitèrent toutes les parties de mes vêtements et me prirent non seulement tout mon ambre et mon or, mais ma montre et une de mes boussoles de poche. Heureusement, la nuit précédente j’avais enterré dans le sable mon autre boussole, et cet instrument et les vêtements que j’avais sur moi étaient alors tout ce que me laissa la barbarie d’Ali.
L’or et l’ambre flattaient singulièrement l’avarice maure, et la boussole devint bientôt l’objet d’une superstitieuse curiosité. Ali voulut savoir pourquoi l’aiguille, qu’il appelait « le petit morceau de fer », se tournait toujours du côté du grand désert. Je fus un peu embarrassé pour répondre à cette question. Si j’avais dit que je l’ignorais, il n’aurait pas manqué de soupçonner que je cherchais à lui cacher la vérité. Ainsi je pris le parti de lui dire que ma mère demeurait bien au-delà des sables de Zaharra, et que tandis qu’elle serait en vie le petit morceau de fer tournerait toujours de ce côté-là et me servirait de guide pour me rendre auprès d’elle, mais que si elle mourait le même petit morceau de fer se tournerait vers sa tombe.
A ces mots, l’étonnement d’Ali redoubla, il regarda de nouveau la boussole, il la tourna et la retourna vingt fois. Mais, voyant qu’elle indiquait toujours le même côté, il me la rendit avec beaucoup de précaution, en me disant qu’il croyait qu’elle renfermait quelque chose de magique et qu’il n’oserait jamais garder un si dangereux instrument.
Le 20 mars, les principaux Maures se rassemblèrent dans la tente d’Ali et on tint conseil sur ce qu’on devait faire de moi. Le résultat ne m’était pas favorable, mais il me fut rapporté de différentes manières. Quelques personnes prétendirent qu’on avait résolu de me faire mourir ; d’autres soutinrent qu’on devait seulement me couper la main droite. Mais ce qui était plus probable c’est ce que me raconta un des fils d’Ali. Cet enfant, âgé d’environ neuf ans, vint le soir dans ma cabane et me dit avec beaucoup d’intérêt « que son oncle avait conseillé au roi son père de me faire arracher les yeux, parce qu’ils ressemblaient à ceux d’un chat, et que tous les buschréens avaient approuvé ce conseil ; mais que son père ne voulait pas faire exécuter cette sentence jusqu’à ce que j’eusse paru devant la reine Fatima, qui était en ce moment dans le Nord ».
Impatient de connaître ma destinée, j’allai le lendemain de grand matin dans la tente du roi. Il y avait déjà plusieurs buschréens assemblés. Je crus ce moment favorable pour découvrir leurs intentions.
Voici comment je m’y pris pour cela : je commençai par demander à Ali la permission de retourner à Jarra, ce qu’il me refusa, en disant que la reine son épouse ne m’avait pas encore vu ; qu’il fallait que je restasse à Benowm jusqu’à l’arrivée de cette princesse ; qu’après je serais maître de partir et que mon cheval qui m’avait été pris le lendemain de mon entrée dans le camp me serait rendu.
Quoique cette réponse ne fût pas très satisfaisante, je fus obligé d’en paraître content. N’ayant aucune espérance de pouvoir m’échapper dans la saison où nous étions, parce que l’excessive chaleur et le manque d’eau dans les bois auraient rendu ma fuite trop difficile, je résolus d’attendre patiemment le commencement des pluies ou quelques circonstances plus heureuses qui pouvaient se présenter. Mais l’espoir déçu rend le cœur malade. Ces ennuyeux délais, qui se renouvelaient chaque jour, et l’idée de voyager dans la Nigritie pendant la saison des pluies, saison dont nous étions déjà très près, me rendirent très mélancolique. Je passai une nuit excessivement inquiète, et le lendemain matin je fus attaqué d’une fièvre violente. Je m’enveloppai dans mon manteau afin de pouvoir transpirer, et je m’endormis.
Tandis que j’étais dans cet état, plusieurs Maures entrèrent dans ma cabane, et avec leur grossièreté ordinaire ils ôtèrent le manteau de dessus moi et me réveillèrent. Je leur fis signe que j’étais malade et que j’avais grande envie de dormir. Ce fut en vain. Ma peine était pour eux un sujet de plaisanterie, et ils tâchèrent de l’augmenter par tous les moyens possibles. Cette insolence recherchée et méprisante à laquelle je me trouvais constamment en butte était un des ingrédients les plus amers dans la coupe de la captivité, et souvent elle me rendit la vie un fardeau presque insupportable. Dans ces pénibles moments, j’enviais la situation des esclaves nègres qui, au milieu de tous leurs maux, pouvaient au moins jouir tranquillement de leur pensée, satisfaction à laquelle j’étais alors étranger.
Fatigué des insultes continuelles des Maures entrés dans ma cabane, et peut-être aussi aigri par la fièvre, je craignis que ma colère n’outrepassât les bornes de la prudence et ne me portât à quelque acte de ressentiment dont ma mort eût été la suite inévitable. Pour me dérober à ce danger, je sortis et j’allai me coucher à l’ombre de quelques arbres qui étaient à peu de distance du camp. Mais la persécution m’y suivit, et la solitude semblait une chose trop douce pour un chrétien. Un fils d’Ali, accompagné d’une troupe de cavaliers, vint vers moi au galop et m’ordonna de me lever et de le suivre. Je le suppliai de me laisser reposer en cet endroit, ne fût-ce que pour quelques heures. Mais le prince et ses compagnons se soucièrent fort peu de ce que je disais, et après beaucoup de menaces un d’entre eux tira d’un sac de cuir qui était pendu à l’arçon de sa selle un pistolet avec lequel il m’ajusta. Il tira deux fois la détente, sans que le feu prît à l’amorce. Je voyais en lui un si grand air d’indifférence que je crus d’abord que le pistolet n’était pas chargé, mais il le banda une troisième fois, et il se mit à frapper la pierre avec un morceau d’acier. Alors je le priai de vouloir bien m’épargner, et je rentrai dans le camp avec la troupe.
Quand nous entrâmes dans la tente d’Ali, ce prince paraissait extrêmement irrité. Il demanda le pistolet du Maure qui avait voulu tirer sur moi. Il essaya trois ou quatre fois si le ressort allait bien, puis il y mit une amorce fraîche de sa propre poudre et, tournant autour de moi avec un regard menaçant, il dit quelques mots arabes que je ne compris pas. Voyant mon Nègre Demba assis devant la tente, je le chargeai de demander en quoi j’avais offensé le roi. Alors j’appris que, comme j’étais sorti du camp sans la permission d’Ali, on croyait que j’avais formé le dessein de m’évader, et, d’après cela, l’ordre était donné pour que la première personne qui me rencontrerait désormais hors des limites du camp me brûlât la cervelle.
L’après-midi, l’horizon fut épais et brumeux du côté de l’Est, et les Maures annoncèrent un vent de sable. Il commença en effet le lendemain matin et souffla pendant deux jours avec de légères interruptions. Le vent n’était pas précisément très fort ; c’était ce qu’un marin aurait appelé une brise raide : la quantité de sable et de poussière qu’il portait obscurcissait le ciel. L’air épaissi courait de l’Est à l’Ouest, comme un vaste fleuve, et il était de temps en temps si chargé de sable que d’une tente on avait de la peine à distinguer les autres. Il tomba beaucoup de ce sable dans le kouskous des Maures parce que, suivant leur coutume, ils font cuire leur manger en plein air. Ce sable s’attachait aussi à la peau, qui dans cette saison est toujours moite, et tout le monde était poudré à bon marché. Lorsque le vent de sable souffle, les Maures mettent un linge sur leur visage pour ne pas respirer du sable, et ils se tournent toujours de manière qu’il n’en entre pas dans leurs yeux.
Vers ce temps-là, toutes les femmes du camp teignirent leurs pieds et le bout de leurs doigts d’une forte couleur de safran. Il me fut impossible de savoir si c’était pour un motif de religion ou comme un ornement. L’importunité des dames maures m’avait beaucoup tracassé depuis mon arrivée à Benowm. Dans la soirée du 25 mars, il en vint une troupe dans ma cabane. Je ne puis dire si elles cédaient à l’instigation de quelqu’un, si elles étaient poussées par leur indomptable curiosité, ou si elles ne voulaient que s’amuser, mais elles me firent entendre que l’objet de leur visite était de vérifier si la loi qui ordonne la circoncision était suivie par les nazaréens comme par les sectateurs de Mahomet. L’on peut aisément juger de ma surprise en apprenant qu’elles avaient un pareil dessein. Pour me dérober à l’examen dont j’étais menacé, je pris le parti de traiter la chose comme une plaisanterie. J’observai à ces dames que dans ces sortes de cas l’usage de mon pays n’était pas de donner des démonstrations oculaires devant un aussi grand nombre de jolies femmes, mais que si elles voulaient se retirer, à l’exception d’une seule, je satisferais la curiosité de cette belle. En même temps je désignai la plus jeune et la plus jolie de la troupe.
Ces dames entendirent fort bien la plaisanterie. Elles s’en allèrent en riant de bon cœur ; et, quoique la jeune dame à laquelle j’avais donné la préférence ne se souciât pas d’en profiter, elle fut assez contente de cet hommage, car bientôt après elle m’envoya de la farine et du lait pour mon souper.
Le 28 mars, on mena dans le camp un nombreux troupeau de bétail qu’on était allé chercher du côté de l’Est. L’un des conducteurs à qui le roi avait prêté mon cheval vint dans ma cabane me faire présent d’un jarret de gazelle et me dire que mon cheval était devant la tente d’Ali. Peu de temps après, Ali m’envoya un de ses esclaves pour m’avertir que l’après-dîner je monterais à cheval avec lui, parce qu’il avait envie de me faire voir quelques-unes de ses femmes.
Vers les quatre heures après midi, Ali, suivi de six de ses courtisans, se rendit à cheval auprès de ma cabane et me dit de le suivre. J’obéis à l’instant. Mais il s’éleva ici une nouvelle difficulté. Les Maures, accoutumés à des vêtements amples et aisés, ne pouvaient pas se faire à la vue de mes culottes de nankin, qu’ils disaient être non seulement sans élégance, mais d’une forme si étroite qu’elles leur paraissaient indécentes. Comme il s’agissait cette fois de rendre visite à des dames, Ali ordonna à mon Nègre Demba de me donner le manteau que j’avais toujours porté depuis mon arrivée à Benowm, et il me dit de m’en envelopper.
Nous allâmes dans les tentes de quatre différentes dames ; et dans chacune on me servit une jatte de lait et d’eau. Toutes ces femmes étaient extrêmement grasses, ce qui dans ces contrées est considéré comme la plus grande marque de beauté. Elles me firent des questions sans nombre, et examinèrent mes cheveux et ma peau avec une extrême attention. Cependant elles affectèrent de me regarder comme un être d’une espèce inférieure à la leur, et elles fronçaient les sourcils et levaient les épaules en regardant la blancheur de ma peau.
Cet après-dîner, mes vêtements et ma mine devinrent un grand sujet d’amusement pour Ali et pour sa suite. Ils galopaient autour de moi comme autour d’un animal sauvage qu’on veut harceler. Ils faisaient tourner leurs fusils par-dessus leur tête, et déployaient toute l’adresse qu’ils avaient à conduire leurs chevaux afin de montrer combien ils étaient supérieurs à un misérable captif.
Certes, les Maures sont de très bons cavaliers. Ils montent à cheval sans crainte. Ils ont des selles dont les arçons de devant et de derrière sont si hauts qu’ils y sont bien en sûreté, et, si par hasard ils tombent de cheval, leur pays est tellement couvert de sable qu’ils ne se font presque jamais le moindre mal. Ce qui flatte beaucoup leur orgueil, et fait un de leurs principaux amusements, c’est de faire galoper un cheval ventre à terre, et de l’arrêter tout à coup en tirant la bride de manière à donner à l’animal une si forte secousse qu’il en est souvent déhanché.
Ali montait ordinairement un cheval blanc dont la queue était peinte en rouge. Jamais il n’allait à pied que pour se rendre à l’endroit où il faisait ses prières. La nuit, on tenait toujours au piquet, à peu de distance de sa tente, trois ou quatre chevaux sellés. Les Maures attachent un très grand prix à leurs chevaux, car c’est à la vitesse de ces animaux qu’ils doivent la facilité de faire tant d’excursions dévastatrices dans les pays appartenant aux Nègres. Ils les pansent trois à quatre fois par jour, et le soir ils leur donnent ordinairement une grande quantité de lait doux, que ces animaux paraissent aimer beaucoup.
Le 3 avril avant midi, un enfant qui avait été quelque temps malade mourut dans une tente voisine de ma cabane. Aussitôt la mère et ses parents firent entendre les cris d’usage en ces sortes d’occasions. Plusieurs femmes allèrent joindre leurs glapissantes voix à ce sombre concert. Je ne pus pas voir les funérailles, mais je sus qu’ordinairement les Maures enterrent leurs morts secrètement à l’entrée de la nuit, et à très peu de distance de leur tente. Ils plantent sur la tombe un arbuste particulier, et ils ne souffrent pas qu’un étranger en arrache une feuille, ou même y touche, tant est grande la vénération qu’ils ont pour les morts
Le 7 avril, à quatre heures après midi, il y eut un tourbillon de vent si violent qu’il renversa trois tentes et emporta un côté de ma cabane. Ces tourbillons viennent du grand désert, et dans cette saison ils sont si communs que j’en ai vu jusqu’à six à la fois. Ils élèvent beaucoup de sable à une très grande hauteur, et alors ils ressemblent de loin à des colonnes de fumées très agitées.
Le soleil ardent qui frappait verticalement un sol aride et sablonneux rendait la chaleur insupportable. Je ne pus pas juger à quel degré elle était, parce qu’Ali m’avait pris mon baromètre. Mais je sais que dans le milieu du jour, lorsque les rayons du soleil et le vent brûlant du désert échauffaient la terre, il n’était pas possible d’y marcher pieds nus. Les Nègres esclaves eux-mêmes n’allaient pas d’une tente à l’autre sans prendre des sandales. C’était l’heure où les Maures restaient couchés dans leurs tentes, soit pour dormir, soit seulement pour ne faire aucun mouvement. Pour moi, je trouvais quelquefois le vent si chaud que je ne pouvais pas, sans souffrir beaucoup, tenir ma main dans les courants d’air qui passaient par les crevasses de ma cabane.
Le 8 avril, le vent souffla du sud-ouest, et dans la nuit il tomba beaucoup de pluie accompagnée de tonnerre et d’éclairs.
Le 10 avril, le bruit d’un grand tambour, qu’on appelle le tabala, annonça un mariage qui se célébrait dans une tente de mon voisinage. Plusieurs personnes des deux sexes s’y rassemblèrent, mais sans cette joie, sans cette gaieté qui accompagnent toujours les mariages des Nègres. Il n’y avait ni chant, ni danse, ni aucune autre espèce d’amusement. Une femme battait le tambour, et les autres personnes de son sexe poussaient toutes à la fois, à intervalles égaux, un cri glapissant. En même temps, on leur voyait remuer leurs langues d’un côté de la bouche à l’autre avec une extrême célérité.
Bientôt, lassé de ce spectacle, je m’en retournai dans ma cabane, où je commençais à m’endormir, lorsqu’une vieille femme entra, tenant une gamelle dans sa main et me disant qu’elle m’apportait un présent de la part de la nouvelle mariée. Avant que j’eusse eu le temps de revenir de la surprise que me causait un tel message la vieille eut versé sur mon visage ce que contenait sa gamelle. Je reconnus alors que c’était la même espèce d’eau lustrale dont les prêtres hottentots arrosent les nouveaux mariés, et je crus que la vieille me jouait un tour, mais elle m’assura très sérieusement que ce don venait de la nouvelle épouse elle-même, et qu’en pareil cas les jeunes Maures non mariés recevaient toujours avec reconnaissance une faveur aussi distinguée. Je me conformai donc à l’usage ; je m’essuyai, et je chargeai la vieille de faire mes remerciements à la jeune dame.
Le tambour continua à battre, et les femmes répétèrent leur cri ou leur sifflement pendant toute la nuit. Vers les neuf heures du matin, la nouvelle mariée sortit en cérémonie de la tente de sa mère. Elle était accompagnée d’un grand nombre de femmes portant la tente dont son mari lui avait fait présent. Les unes tenaient les poteaux, les autres les cordes, et toutes poussaient le même cri que la veille. Lorsqu’elles furent rendues dans l’endroit destiné à la résidence des nouveaux époux, elles y plantèrent la tente. Le nouveau marié suivait de près le cortège des femmes. Il avait avec lui un grand nombre d’hommes conduisant quatre taureaux qu’on attacha aux piquets de la tente. Ensuite on en tua un cinquième, dont on distribua la viande aux spectateurs, et la cérémonie fut terminée.
XI Détail de ce qui se passe dans le camp des Maures. — Observations sur les villes de Houssa et de Tombuctou. — Description de la route de Maroc à Benowm. — M. Mungo Park souffre beaucoup de la faim. — Ali transporte son camp plus avant dans le Nord. — M. Mungo Park, obligé de suivre le camp d’Ali, est présenté à la reine Fatima. — L’eau manque dans le camp.
Un mois entier s’était écoulé depuis que je languissais dans le camp des Maures et que chaque jour m’apportait quelque nouveau malheur. J’observais avec impatience la marche lente de l’astre du jour, et je bénissais le moment où ses rayons, prêts à disparaître, ne répandaient plus qu’une pâle clarté sur le sol sablonneux où était construite ma cabane, parce que, quoique pendant les nuits la chaleur fût étouffante, je pouvais au moins les passer dans la solitude et me livrer entièrement à mes réflexions.
Vers minuit, on apportait dans ma cabane une gamelle de kouskous, avec du sel et de l’eau. Nous le mangions ensemble, Demba, Johnson et moi, et c’était tout ce qu’on nous donnait pour apaiser notre faim et supporter notre existence pendant le jour suivant, car c’était alors le temps du rhamadan. Les Maures, accoutumés à jeûner rigoureusement pendant leur carême, jugeaient à propos que, moi chrétien, j’observasse la loi comme eux.
Cependant, au bout de quelque temps je m’accoutumai à cette diète. Je vis que je pouvais supporter la faim et la soif beaucoup mieux que je ne m’y attendais ; et enfin, pour abréger les longues heures, j’essayai d’apprendre à écrire l’arabe. Les gens qui venaient me voir m’eurent bientôt appris à connaître les caractères, et je m’aperçus qu’en fixant ainsi leur attention ils devenaient moins importuns. Aussi, lorsque je lisais dans les yeux de quelqu’un d’entre eux qu’il avait envie de me faire une malice je me hâtais de l’engager à écrire quelque chose sur le sable, ou à déchiffrer ce que j’y écrivais moi-même, et l’orgueil de montrer ses connaissances faisait presque toujours qu’il accédait à ma demande.
Le 14 avril, Ali, voyant que Fatima ne venait point, se disposa à aller la chercher. Il y avait deux journées de marche depuis Benowm jusqu’au lieu plus septentrional où était la reine ; ainsi, il était nécessaire d’avoir de quoi manger en route. Mais le soupçonneux Ali craignait tellement d’être empoisonné qu’il ne mangeait ni ne buvait que ce qu’il faisait préparer devant lui. Il fit tuer un jeune bœuf ; on en coupa la viande par tranches, et on la fit sécher au soleil. Cette viande et deux sacs de kouskous sec furent toutes les provisions du voyage.
Avant le départ d’Ali, les habitants noirs de la ville de Benowm vinrent, suivant la coutume, lui montrer leurs armes et lui payer leur tribut annuel de blé et de toile. Ils étaient mal armés. Vingt-deux d’entre eux avaient des fusils ; quarante à cinquante, des arcs et des flèches, et un pareil nombre d’hommes et de jeunes garçons n’avait que des lances. Ils se tinrent rangés devant la tente d’Ali, jusqu’à ce que leurs armes fussent examinées et quelques petites disputes terminées.
Le 16 avril à minuit, Ali quitta sans bruit son camp de Benowm. Il ne prit avec lui qu’un très petit nombre de ses gens, et il annonça qu’il serait de retour dans neuf ou dix jours.
Deux jours après le départ d’Ali, un shérif arriva au camp, avec du sel et quelques autres marchandises. Il venait de Walet, capitale du royaume de Birou. Comme on ne lui avait point préparé de tente, il vint loger dans la cabane où j’étais. Il paraissait fort instruit, et la connaissance qu’il avait de la langue arabe et de celle des Bambaras le mettait à même de voyager avec facilité et avec sûreté dans plusieurs royaumes. Quoiqu’il résidât ordinairement à Walet, il était allé à Houssa, et il avait passé quelques années à Tombuctou. Voyant que je m’informais avec attention de la distance de Walet à Tombuctou, il me demanda si je me proposais de voyager dans ces contrées. Je lui répondis que oui. Alors il secoua la tête, en disant que cela ne se pouvait pas, parce que les chrétiens y étaient regardés comme les enfants du diable et les ennemis du prophète. Voici ce qu’il m’apprit ensuite.
« Houssa est la plus grande ville que j’aie jamais vue, Walet est plus grand que Tombuctou ; mais comme il est éloigné du Niger, et que son principal commerce est en sel, on y voit beaucoup moins d’étrangers. De Benowm à Walet il y a dix journées de marche. En se rendant d’un de ces lieux à l’autre, on ne voit aucune ville remarquable, et on est obligé de se nourrir du lait qu’on achète des Arabes, dont les troupeaux paissent autour des endroits où il y a des puits ou des mares. On traverse pendant deux jours un pays sablonneux, dans lequel on ne trouve point d’eau.
« Il faut ensuite onze jours pour se rendre de Walet à Tombuctou. Mais l’eau est beaucoup moins rare sur cette route, et l’on y voyage ordinairement sur des bœufs. On voit à Tombuctou un grand nombre de juifs, qui tous parlent arabe et se servent des mêmes prières que les Maures. »
Le shérif de Walet me montra de la main le sud-est, ou plutôt l’est-quart de sud, disant que Tombuctou était de ce côté-là. Je lui fis plusieurs fois répéter cette indication, et il ne varia jamais de plus d’un demi-rumb de vent, c’est-à-dire qu’alors il tourna sa main un peu plus vers le sud.
Dans la matinée du 24 avril, un autre shérif, natif de Maroc et nommé Sidi Mahomet Moura Abdalla, arriva avec cinq bœufs chargés de sel. Pendant un séjour de quelques mois qu’il avait fait anciennement à Gibraltar, il avait appris assez d’anglais pour se faire entendre dans cette langue. Il me dit qu’il avait été cinq mois pour venir de Santa-Cruz, mais que la plus grande partie de ce temps avait été employée à faire le commerce.
Je le priai de me dire combien de jours il lui avait fallu pour se rendre de Maroc à Benowm, et il me calcula la route de la manière suivante : « Il faut, pour aller de Maroc à Swera, 3 jours ; de Swera à Agadier, on en met 3 ; d’Agadier à Giniken, 10 ; de Giniken à Wadenoun, 4 ; de Wadenoun à Lakeneig, 5 ; de Lakeneig à Zeeriwin-Zeriman, 5 ; de Zeeriwin-Zeriman à Tischéet, 10 ; et de Tischéet à Benowm d10ix, ce qui fait en tout cinquante jours. Mais les voyageurs s’arrêtent ordinairement longtemps à Giniken et à Tischéet. C’est à Tischéet qu’on fouille le sel gemme, dont on fait un très grand commerce avec les Nègres. »
En m’entretenant avec ces deux schérifs et avec les autres étrangers qui venaient au camp d’Ali, je passai le temps moins ennuyeusement que dans les premiers jours de ma captivité. En revanche, j’éprouvai un nouveau désagrément. Les esclaves d’Ali étaient chargés de préparer ce qu’il me fallait pour vivre, et, comme je n’avais sur eux aucune espèce d’autorité, ils me donnaient beaucoup moins à manger que durant le mois du carême. Ils restèrent deux nuits de suite sans apporter la pitance accoutumée qui servait à nourrir mes deux Nègres et moi. Demba se rendit alors dans une petite ville habitée par des Nègres et peu éloignée du camp. Il y mendia de porte en porte, mais il ne put obtenir que quelques poignées de pistaches, qu’il vint aussitôt partager avec moi.
La faim est d’abord très pénible à supporter, mais au bout de quelque temps la douleur qu’elle cause dégénère en langueur et en débilité ; et alors un peu d’eau qu’on boit, tenant l’estomac tendu, ranime les esprits et écarte pour quelques instants toute sorte de malaise. Johnson et Demba étaient extrêmement abattus. Ils restaient couchés sur le sable et plongés dans un sommeil presque léthargique ; et lorsqu’enfin on nous apporta du kouskous j’eus de la peine à les réveiller. Pour moi, je ne me sentis aucune envie de dormir, mais ma respiration était convulsive et ressemblait à une continuité de soupirs. Ce qui m’alarmait le plus, c’était de sentir ma vue s’affaiblir, de me trouver prêt à m’évanouir toutes les fois que je voulais me tenir debout. Ces symptômes de faiblesse ne m’abandonnèrent que quelque temps après que j’eus pris de la nourriture.
Nous attendîmes quelques jours en vain qu’Ali et Fatima revinssent du Sahel. Pendant ce temps-là, Mansong, roi du Bambara, fit, ainsi que je l’ai déjà rapporté, demander à Ali un corps de cavalerie pour l’aider à donner l’assaut à la ville de Gédingouma. Non seulement Ali refusa d’accéder à cette demande, mais il traita les envoyés de Mansong avec beaucoup de hauteur et de mépris. Alors Mansong renonça au projet de s’emparer de Gédingouma, et résolut de se venger aussitôt d’Ali.
Dès le 29 avril un messager vint annoncer à Benowm que l’armée du Bambara s’approchait des frontières du Ludamar. Cette nouvelle répandit l’alarme dans tout le pays. L’après-midi, un fils d’Ali, ayant à sa suite une vingtaine de cavaliers, arriva au camp. Il donna ordre d’emmener tout le bétail, d’abattre les tentes, et il fit avertir tout le monde de se tenir prêt à partir le lendemain à la pointe du jour.
Le 30 avril, dès que l’aube parut, tout le camp fut en mouvement. On emporta tout le bagage sur des bœufs : les deux poteaux et tous les bois qui dépendaient d’une tente étaient placés de chaque côté d’un bœuf et recouverts de la toile de la tente sur laquelle on faisait asseoir une ou deux femmes, car les femmes maures sont très peu accoutumées à marcher. Les concubines d’Ali étaient montées sur des chameaux, qui avaient des selles d’une construction particulière, avec un pavillon qui garantissait ces dames du soleil.
Nous marchâmes droit au nord. A midi, le fils d’Ali fit entrer la caravane dans un bois épais et bas qui était à droite du chemin. Il n’en excepta que deux tentes, avec lesquelles on m’envoya, et le soir nous arrivâmes à Farani, ville habitée par des Nègres. Nous plantâmes nos tentes dans un endroit bien découvert à peu de distance de la ville.
La confusion et les embarras occasionnés par le décampement avaient empêché les esclaves de préparer à manger comme de coutume ; et, comme à l’exception du roi Ali et des principaux Maures tout le monde ignorait en quel endroit on allait, et qu’on avait peur que les provisions sèches manquassent avant qu’on y arrivât, on jugea à propos de regarder le jour du départ comme un jour de jeûne.
Le 1er mai, j’eus quelque appréhension qu’on ne me fît encore jeûner ce jour-là comme la veille. En conséquence, j’entrai dans la ville de Farani, et je priai le douty de me donner quelque chose à manger. Ce bon Nègre se hâta de me faire part de ce qu’il avait, et me recommanda de venir tous les jours chez lui pendant que je serais dans son voisinage. Les Maures regardent les généreux habitants de Farani comme une race abjecte d’esclaves, et ils les traitent avec la plus brutale insolence.
Un homme et une femme, tous deux esclaves du roi, avaient suivi les deux tentes avec lesquelles j’étais. Le matin ils menèrent boire leur bétail aux puits de la ville, dans lesquels il y avait très peu d’eau. Quand les Négresses qui puisaient de l’eau virent approcher les bétails, elles prirent leurs cruches et se hâtèrent de marcher vers la ville. Mais, avant qu’elles pussent y entrer, les esclaves d’Ali les arrêtèrent et les forcèrent de rapporter leurs cruches aux puits et de les vider dans les auges. Ils leur firent même tirer de l’eau, parce qu’il n’y en avait pas assez pour le bétail, et la femme esclave cassa deux gamelles sur la tête des Négresses de Farani, parce qu’elles ne tiraient pas l’eau aussi vite qu’elle le voulait.
Le 3 mai, nous quittâmes le voisinage de Farani, et après avoir suivi un chemin tortueux dans les bois nous arrivâmes l’après-midi au camp d’Ali. Ce nouveau camp, plus vaste que celui de Benowm, était placé au milieu d’une grande forêt, et à environ deux milles de distance d’une ville nègre appelée Boubeker.
En arrivant au camp, je me rendis dans la tente d’Ali pour présenter mon respect à la reine Fatima, qui était venue avec lui du Sahel. Ali parut satisfait de me voir ; il me toucha la main, et dit à la reine que j’étais ce chrétien dont on lui avait parlé. Fatima était de la caste des Arabes. Elle avait de longs cheveux noirs et une excessive corpulence. Il me sembla d’abord qu’elle était choquée de voir un chrétien aussi près d’elle. Cependant, elle m’interrogea, par le moyen d’un jeune Nègre qui parlait l’arabe et le mandingue, et lorsque j’eus répondu à plusieurs de ses questions sur le pays des chrétiens elle parut plus à son aise, et me présenta une jatte de lait, ce que je considérai comme un favorable augure.
La chaleur était extrême ; toute la nature en était accablée. Le pays représentait à l’œil une vaste étendue de sable, où croissaient de loin en loin quelques arbres rabougris et quelques buissons hérissés d’épines. Les chameaux et les lèvres broutaient le peu de feuilles qu’avaient ces arbres et ces buissons, tandis que les bœufs et les vaches affamés paissaient à côté l’herbe flétrie.
Là, l’eau était plus rare qu’à Benowm. Jour et nuit les puits étaient entourés de bétail mugissant et combattant pour s’approcher de l’abreuvoir. L’excessive soif rendait beaucoup de taureaux furieux. D’autres, trop faibles pour disputer l’eau, cherchaient à étancher leur soif en dévorant le limon noir des égouts à l’entour des puits, ce qui leur devenait presque toujours fatal.
Cette grande rareté d’eau était cruellement sentie par tous les gens du camp, mais nul n’en souffrait autant que moi. Il est bien vrai que Fatima me donnait un peu d’eau une ou deux fois par jour, et qu’Ali m’avait permis d’avoir une outre à moi, mais presque toutes les fois que mon Nègre Demba s’approchait des puits pour la remplir les grossiers et cruels Maures qui s’y trouvaient le repoussaient à coups de bâton. Tous les Maures étaient étonnés que l’esclave d’un chrétien osât tirer de l’eau des puits qui avaient été creusés par les sectateurs du prophète. A la fin, la brutalité de ces Barbares effraya tellement Demba qu’il aurait, je crois, préféré de mourir de soif à essayer d’aller remplir mon outre. Il se contentait de mendier de l’eau des Nègres esclaves qui servaient dans le camp. Je suivais son exemple, mais avec très peu de succès. Quoique je ne laissasse échapper aucune occasion, quoique mes sollicitations fussent très pressantes auprès des Maures et auprès des Nègres, je n’obtenais que rarement de quoi boire. Pour comble de malheur, je passais souvent la nuit à éprouver le supplice de Tantale. Je n’étais pas plutôt endormi que mon imagination me transportait auprès des ruisseaux et des rivières de ma patrie. Il me semblait que je me promenais sur leurs bords verdoyants, que je voyais avec transport couler leurs ondes claires ; que je m’avançais pour en boire ; mais hélas ! elles fuyaient de mes lèvres, et ce malheur me réveillait. Alors je me retrouvais tel que j’étais en effet, un malheureux et solitaire captif, périssant de soif au milieu des déserts de l’Afrique.
Une nuit que j’avais en vain demandé de l’eau dans le camp, je résolus de tenter de m’en procurer un peu aux puits éloignés des tentes d’environ un demi-mille. Je partis à minuit pour y aller, et, guidé par le mugissement du bétail, j’y fus bientôt rendu. J’y trouvai des Maures occupés à tirer de l’eau. Je les priai de me laisser boire, mais ils me refusèrent en m’accablant d’injures. Passant d’un puits à l’autre, j’en vois enfin un auprès duquel il n’y avait qu’un vieillard. Aussitôt il me présenta un seau qu’il venait de remplir, mais, comme j’en approchais, il se rappela que j’étais chrétien et, craignant que son seau ne fût souillé par mes lèvres, il versa l’eau dans une auge et me dit d’y boire. Quoique l’auge fût très petite et qu’il y eût déjà trois vaches qui y buvaient, je me décidai à prendre ma part de l’eau. Je me mis à genoux, je passai ma tête entre celles de deux vaches, et je bus avec grand plaisir jusqu’à ce que l’eau fut presque épuisée et que les vaches commencèrent à se disputer la dernière gorgée.
Le mois de mai, si chaud en Afrique, se passa comme je viens de le raconter et n’apporta aucun changement dans ma situation. Ali me regardait toujours comme un homme qu’il avait droit de retenir prisonnier, et quoique Fatima me fît donner une plus grande quantité de nourriture que je n’en avais eu à Benowm elle n’avait encore rien dit au sujet de ma délivrance. Cependant, les fréquents changements de vent, les nuages qui s’assemblaient, les éclairs qui partaient du bout de l’horizon, tout enfin indiquait l’approche de la saison des pluies, temps où les Maures s’éloignent du pays des Nègres pour aller habiter les confins du grand désert. Sentant bien que mon sort ne pouvait pas tarder à se décider, je pris le parti d’attendre ce moment, sans montrer la moindre impatience ; mais il survint des événements qui opérèrent en ma faveur un changement bien plus prompt que je ne l’avais prévu.
Les transfuges du Kaarta qui s’étaient retirés dans le Ludamar, voyant que les Maures étaient prêts à les quitter, et craignant le ressentiment du roi Daisy, qu’ils avaient si lâchement abandonné, proposèrent à Ali de leur fournir deux cents cavaliers maures pour les aider à chasser Daisy de Gédingouma, car ils pensaient que, tant que ce prince ne serait pas vaincu, ils ne pourraient ni rentrer dans leur patrie ni vivre en sûreté dans les royaumes voisins.
Dans l’intention d’extorquer l’argent de ces transfuges, au moyen du traité qu’ils lui proposaient, Ali fit partir l’un de ses fils pour Jarra, se proposant de le suivre lui-même sous peu de jours. Cette circonstance me sembla trop importante pour que je ne dusse pas chercher à en profiter. Fatima avait la principale part dans la direction des affaires. Je m’adressai à elle, et la suppliai de faire en sorte qu’Ali m’accordât la permission d’aller avec lui à Jarra. Cette prière fut favorablement écoutée. Fatima me regarda avec douceur, et me parut touchée de compassion. Elle fit tirer mes paquets du grand sac de cuir où on les avait mis, et me dit de lui expliquer l’usage des choses qu’ils contenaient et de lui montrer comme on met les bas, les bottes, et les divers vêtements. Je fis avec empressement ce qu’elle désirait. Après quoi elle me dit que dans peu de jours je serais maître de partir.
Ne doutant pas que si je pouvais aller à Jarra je ne trouvasse les moyens de m’échapper de cette ville, je me livrai au doux espoir de voir ma captivité bientôt terminée. Comme heureusement cet espoir ne fut point déçu, je vais m’arrêter un moment pour rassembler sous un même point de vue quelques observations sur le caractère des Maures et sur leur pays, car jusqu’à présent il ne m’a pas été possible de les faire entrer convenablement dans ma narration.
XII Réflexions sur le caractère et les mœurs des Maures. — Observations sur le grand désert et sur les animaux sauvages et domestiques de ce pays.
Les Maures de cette partie de l’Afrique sont divisés en plusieurs tribus indépendantes. Suivant ce que j’ai appris sur les lieux, les plus redoutables de ces tribus sont celles de Trasart et d’Il-Braken, qui habitent sur la rive septentrionale du Sénégal. Les tribus de Gédingouma, de Jafnou et de Ludamar, quoique moins nombreuses que les deux premières, sont puissantes et belliqueuses. Chaque tribu est gouvernée par un chef ou roi, qui jouit d’une autorité absolue.
Les Maures sont pasteurs, et en temps de paix ils ne s’occupent guère que du soin de leurs troupeaux. Ils se nourrissent de la chair de ces troupeaux, et ils passent alternativement de la voracité à l’abstinence. Les jeûnes fréquents et rigoureux que leur prescrit leur religion et les pénibles voyages qu’ils font à travers le désert les rendent capables d’endurer la faim et la soif avec un courage étonnant ; mais, quand l’occasion de satisfaire leur appétit se présente, il n’en est presque aucun qui, dans un seul repas, ne mange plus que ne mangeraient trois Européens. Ils s’occupent très peu de l’agriculture. Les Nègres leur fournissent du grain, de la toile de coton et d’autres objets de nécessité, et reçoivent en échange du sel gemme que les Maures tirent des mines du grand désert.
Le pays qu’habitent les Maures est si stérile qu’il ne produit que très peu d’objets propres à être manufacturés. Cependant les Maures fabriquent eux-mêmes une étoffe très forte dont ils couvrent leurs tentes, et qui provient du poil des chèvres, filé par les femmes maures. Ces femmes préparent aussi les cuirs dont on fait les selles, les brides, les valises, et divers autres objets.
Les Maures sont assez adroits pour faire des piques, des couteaux et même des marmites avec le fer natif que leur fournissent les Nègres ; mais ils achètent des Européens leurs sabres, leurs armes à feu et leurs munitions, et ils les paient avec des Nègres qu’ils enlèvent dans les royaumes voisins. Leur principal commerce en ce genre se fait avec les Français qui fréquentent les bords du Sénégal.
Les Maures sont mahométans rigides. Ils ont non seulement la bigoterie et les superstitions de leur secte, mais toute son intolérance. A Benowm, il n’y a point de mosquée ; les prières s’y font dans une enceinte formée avec des nattes et découverte. Celui qui y préside est à la fois prêtre et maître d’école. Ses écoliers s’assemblent tous les soirs devant sa tente, où à la clarté d’un grand feu fait avec des broussailles et de la bouse de vache on leur apprend quelques sentences du Koran et on les initie dans les principes de leur religion. Leur alphabet est très peu différent de celui qu’on trouve dans la grammaire arabe de Richardson.
Les prêtres maures feignent de connaître la littérature étrangère. Celui de Benowm m’assura qu’il était en état de lire les livres des chrétiens. Il me montra plusieurs caractères barbares qu’il prétendait être l’alphabet romain. Il en avait d’autres non moins inintelligibles, qu’il donnait pour du kallam il indi, c’est-à-dire du persan. Sa bibliothèque consistait en neuf volumes in-quarto, dont la plupart étaient, je crois, des livres de religion, car le nom de Mahomet se voyait presque à chaque page, tracé en caractère rouge.
Les écoliers de Benowm écrivent ce qu’on leur apprend sur des planchettes, car le papier y est trop cher pour qu’on ne le ménage pas beaucoup. Ces écoliers ne paraissent manquer ni d’activité ni d’émulation. Pendant qu’ils vaquent à leurs occupations journalières, ils portent toujours leurs planchettes pendues derrière le dos. Quand un jeune homme a appris par cœur quelques prières et sait lire et écrire certains passages du Koran, il est regardé comme suffisamment instruit, et avec cette petite provision de savoir il n’est plus au rang des enfants. Fier de ses connaissances, il regarde avec mépris les Nègres illettrés, et choisit toutes les occasions de montrer sa supériorité sur ceux de ses compatriotes qui ne possèdent pas autant de science que lui.
L’éducation des filles maures est totalement négligée. Les femmes de cette nation se soucient fort peu des qualités morales, et les hommes ne regardent pas en elles comme un défaut le manque de ces qualités. Ils croient que les femmes sont d’une espèce inférieure à la leur, et créées seulement pour les plaisirs et les caprices d’un maître impérieux. Le goût de la volupté est donc considéré comme leur principale qualité, et la soumission la plus servile comme leur indispensable devoir.
Les Maures ont de singulières idées sur la beauté des femmes. Ils ne font grand cas ni d’une taille élégante, ni d’une démarche agréable, ni d’une physionomie remplie d’expression. Mais chez eux la corpulence et la beauté paraissent synonymes. Lorsqu’une femme n’a besoin que de deux esclaves qui la soutiennent sous le bras pour l’aider à marcher, elle ne peut avoir que des prétentions modérées ; mais celle à qui il faut au moins un chameau pour la porter est reconnue pour une beauté parfaite. Ce goût que les Maures ont pour les beautés massives fait que les femmes prennent de bonne heure beaucoup de peine pour le devenir. Les mères forcent même tous les matins les jeunes filles à manger une énorme quantité de kouskous et à boire une grande jatte de lait de chameau. Peu importe que la fille ait de l’appétit ou non, le kouskous et le lait doivent être avalés ; et les coups sont souvent employés pour forcer la rebelle à obéir. J’ai vu une pauvre fille pleurant pendant plus d’une heure avec la jatte sur les lèvres, tandis que sa mère tenait le bâton levé sur elle et s’en servait sans pitié dès que le lait et le kouskous n’étaient pas avalés à sa fantaisie. Ce singulier usage n’occasionne ni des maladies ni des indigestions ; il produit au contraire bientôt dans les jeunes filles un degré d’embonpoint qui, aux yeux d’un Maure, est la perfection elle-même.
Les Maures achètent des Nègres tous leurs vêtements, ce qui fait que leurs femmes sont obligées de s’habiller avec beaucoup d’économie. Elles ne portent en général qu’une pagne, c’est-à-dire un grand morceau de toile de coton qui leur ceint le corps, descend presque jusqu’à terre, et fait à peu près l’effet d’une jupe. Au haut de cette pagne on coud deux pièces carrées, l’une devant, l’autre derrière, et on les attache ensemble sur l’épaule. La coiffure des femmes maures est composée ordinairement d’un bandeau de toile de coton, dont une partie plus large que le reste sert à leur couvrir le visage quand elles vont au soleil. Il faut pourtant observer que souvent elles ne sortent que voilées depuis la tête jusqu’aux pieds.
Les occupations de ces femmes varient suivant le degré de fortune de leurs maris. La reine Fatima et quelques autres font comme les grandes dames d’Europe. Elles passent leur vie à causer avec ceux qui viennent les voir, à dire des prières et à applaudir à leurs charmes devant un miroir. Les femmes d’une classe inférieure s’occupent des soins du ménage. Elles sont vaines, parleuses, et quand quelque chose les met de mauvaise humeur elles en font ordinairement ressentir les effets à leurs Négresses esclaves, sur lesquelles elles exercent l’autorité la plus cruelle et la plus despotique.
Je dois observer, à cette occasion, que la condition de ces malheureuses Négresses est excessivement déplorable. Dès la pointe du jour, elles sont contraintes d’aller chercher de l’eau dans de grandes outres, qu’on appelle des guirbas. Il faut qu’elles charrient assez d’eau pour l’usage de leurs maîtres et pour leurs chevaux, car les Maures permettent rarement qu’on mène ces animaux à l’abreuvoir. Quand l’eau est charriée, les Négresses pilent le maïs et préparent à manger ; et comme cela se fait toujours en plein air elles sont exposées à la triple chaleur du soleil, du feu et du sable. Dans les intervalles, elles balaient la tente ; elles battent la crème pour faire du beurre, et font tout ce qu’il y a de plus pénible. Malgré cela, on les nourrit mal, et elles sont cruellement châtiées.
L’habillement des Maures du Ludamar ne diffère que peu de celui des Nègres que j’ai déjà décrit, mais ils portent en outre le signe caractéristique de la secte de Mahomet, le turban, qui chez eux est toujours de toile de coton blanche. Ceux des Maures qui ont une longue barbe laissent aisément apercevoir combien ils en sont orgueilleux, parce qu’elle montre qu’ils sont d’origine arabe. Le roi de Ludamar, Ali, était de ce nombre. Les autres Maures ont en général les cheveux courts, touffus et extrêmement noirs. Ils font un si grand cas de la barbe que la mienne fut cause qu’ils finirent par avoir un peu moins mauvaise opinion de moi. Elle était venue très longue. Ils la regardaient toujours avec approbation ou avec envie ; et je crois, sur ma conscience, qu’ils pensaient que c’était une trop belle barbe pour un chrétien.
Les seules maladies que j’ai vues assez communes chez les Maures sont la fièvre intermittente et la dysenterie. Les vieilles femmes ont des recettes dont on fait quelquefois usage contre ces maladies, mais en général les maladies s’abandonnent au seul secours de la nature.
Pendant que je fus captif dans le Ludamar, je ne vis personne attaqué de la petite vérole. Toutefois on me dit qu’elle y faisait de temps en temps de grands ravages, et le docteur Laidley me confirma que du pays des Maures elle passait souvent chez les Nègres du Midi. Le même docteur m’apprit que les Nègres des bords de la Gambie pratiquaient l’inoculation.
Autant que j’ai pu l’observer, les Maures du Ludamar ont une jurisprudence criminelle prompte et décisive ; car, quoique chez eux les droits civils soient peu respectés, on y sent la nécessité d’arrêter par l’exemple du châtiment les hommes portés à commettre le crime. Dans ces sortes d’occasions, je vis toujours conduire le coupable devant Ali, qui le jugeait seul à sa fantaisie ; mais je sus en même temps que les peines capitales n’étaient guère infligées qu’aux Nègres.
Quoique les richesses des Maures consistent principalement dans leurs nombreux troupeaux et que la garde de ces troupeaux soit, ainsi que je l’ai déjà observé, un de leurs soins les plus importants, elle ne les occupe pas sans cesse. Au contraire, la plupart d’entre eux restent presque toujours à ne rien faire, et passent leur vie à s’entretenir inutilement et puérilement de leurs chevaux, ou à former des projets de rapine contre les villages des Nègres.
Les oisifs se rendent ordinairement dans la tente du roi. Là ils se permettent de parler avec beaucoup de liberté les uns des autres, mais à l’égard du prince ils semblent n’avoir qu’une seule opinion. Ils le louent unanimement ; ils chantent souvent en chœur des chansons composées en son honneur, chansons remplies de tant d’adulation qu’il n’y a qu’un despote maure qui puisse les entendre sans rougir.
Le roi est toujours vêtu d’étoffes bien plus belles que celles des autres Maures. Il porte tantôt de la toile de coton bleue, qui vient de Tombuctou, tantôt de la toile de lin ou de la mousseline, qu’on achète au Maroc. Il a aussi une tente plus grande que les autres, et remarquable par la toile blanche qui la couvre. Mais d’ailleurs il oublie fréquemment avec ses sujets toute espèce de distinction de rang. Il n’est pas rare de le voir manger dans la même jatte, et se coucher, pendant la chaleur du jour, sur le même lit que le conducteur de ses chameaux.
Pour subvenir aux dépenses du gouvernement et à l’entretien de sa maison, il perçoit différents impôts. Les Nègres établis dans ses Etats sont obligés de lui payer une taxe en grains, en toile ou en poudre d’or. Il met une seconde taxe sur toutes les korrées ou lieux où l’on puise de l’eau, et on la paye ordinairement en bétail. Toutes les marchandises qui passent dans le pays doivent aussi des droits au roi, droits qui sont toujours prélevés en nature ; mais la plus grande partie des revenus de ce prince provient du pillage et des extorsions. Les Nègres qui habitent le Ludamar et les marchands qui y voyagent tremblent de paraître riches. Ali a dans toutes les villes de son royaume des espions chargés de lui rendre compte de la fortune de ses sujets, et souvent il invente de frivoles prétextes pour s’emparer du bien de ceux qui sont opulents et pour les réduire au niveau des autres.
Il m’est impossible de dire avec exactitude à quoi s’élève le nombre des Maures qui vivent sous les lois d’Ali. Les forces du Ludamar sont sa cavalerie. Cette cavalerie est bien montée et paraît très adroite à escarmoucher et à attaquer par surprise. Chaque cavalier se fournit lui-même son cheval et son armure, qui consiste en un grand sabre, un fusil à deux coups, un sachet de cuir rouge pour mettre les balles et une poire à poudre qu’on porte en bandoulière. Les cavaliers n’ont d’autre paye ni d’autre récompense que ce qu’ils enlèvent par le pillage. Ils ne sont pas en très grand nombre, car lorsqu’Ali était en guerre avec le Bambara je sus que son armée n’était composée que d’environ deux mille hommes de cavalerie. Cependant j’appris que cette cavalerie ne faisait qu’une très petite portion des Maures du Ludamar. Les chevaux des Maures sont extrêmement beaux ; et on les estime tellement que pour en avoir un les princes nègres donnent quelquefois de douze à quatorze esclaves.
Le Ludamar est borné au nord par le grand désert de Sahara. S’il faut en croire toutes les informations que je pris sur cette mer de sable qui occupe un si grand espace dans le nord de l’Afrique, elle est presque entièrement inhabitée, il y a un très petit nombre d’endroits où une légère apparence de végétation excite quelques errants et misérables Arabes à conduire leurs troupeaux ; et dans d’autres où l’on trouve un peu plus d’eau et de pâturage de petites peuplades maures ont fixé leur résidence. Là elles vivent dans une indépendante pauvreté, et ne redoutent point la domination des despotes de la Barbarie. Le reste du désert, étant absolument dépourvu d’eau, ne voit d’autres êtres humains que quelques marchands dont les caravanes forment de temps en temps la pénible et dangereuse entreprise de le traverser. Dans quelques parties de cette vaste solitude, le sable est couvert d’arbustes rabougris qui marquent les haltes des caravanes et fournissent un peu de pâture aux chameaux, mais dans d’autres endroits le voyageur épouvanté ne voit autour de lui que les cieux et une immense étendue de sable. Dans ces lieux si tristement arides, l’œil cherche en vain quelque objet sur lequel il puisse se reposer, et l’âme est sans cesse remplie de la cruelle appréhension de périr de soif. « Au milieu de cette affreuse solitude, le voyageur voit des oiseaux morts que la violence des vents y a portés, et, tandis qu’il réfléchit sur l’effrayante longueur du chemin qui lui reste à faire, il entend avec horreur le sifflement du vent du désert, seul bruit qui interrompt l’épouvantable repos de ces lieux. »
La gazelle et l’autruche sont les seuls animaux qui habitent ces tristes contrées. La légèreté de leur course fait qu’elles se transportent facilement dans les endroits éloignés où il y a de l’eau. Sur les confins du désert, où l’eau est plus facile à trouver, on voit des lions, des panthères, des sangliers et des éléphants.
Le seul animal domestique qui peut résister à la fatigue de traverser le désert est le chameau. Son estomac est si singulièrement conformé qu’il peut y mettre une provision d’eau suffisante pour dix à douze jours. Son pied large et flexible est propre aux pays sablonneux, et par le mouvement extraordinaire de sa lèvre supérieure il dépouille de leurs plus petites feuilles les arbustes épineux qu’il rencontre. Le chameau est donc la seule bête de somme dont se servent les caravanes qui, en faisant le commerce entre les côtes de Barbarie et la Nigritie, traversent le désert de Sahara en différentes directions. Cet animal, à la fois si utile et si docile, a été trop bien décrit par divers auteurs pour que j’aie besoin de m’étendre davantage sur ses bonnes qualités. J’ajouterai seulement que sa chair, qui me paraît sèche et peu savoureuse, est préférée par les Maures à toute autre espèce de viande, et que le lait de sa femelle est, de l’aveu de tous ceux qui en ont goûté, doux, agréable et très nourrissant.
Je l’ai déjà observé, les Maures ressemblent pour la couleur et pour les traits aux mulâtres des Antilles, mais ils ont dans la physionomie quelque chose de désagréable que n’ont point les mulâtres. Je crois avoir lu sur le visage de la plupart d’entre eux de la disposition à la perfidie et à la cruauté, et toutes les fois que je les ai contemplés attentivement je n’ai pu me défendre de beaucoup d’inquiétude. Ils ont dans les yeux un égarement sauvage, qui fait qu’un étranger les prend au premier abord pour un peuple de fous.
La trahison et la méchanceté du caractère des Maures sont prouvées par les vols et les brigandages qu’ils commettent sans cesse dans les villages nègres. Tantôt sans aucun prétexte, tantôt en faisant des assurances d’amitié, ils s’emparent tout à coup du bétail des Nègres, où ils réduisent ces malheureux eux-mêmes en captivité. Les Nègres se vengent rarement de tant de barbarie. Le courage entreprenant des Maures, la connaissance qu’ils ont du pays, et surtout la vitesse de leurs chevaux, les rendent des ennemis très dangereux, et les petits royaumes nègres situés près du désert sont dans des terreurs continuelles, tandis que les tribus maures qui vivent dans leur voisinage se croient trop redoutées pour appréhender la moindre résistance.
Ainsi que l’Arabe vagabond, le Maure change de place à chaque saison et conduit ses troupeaux dans les endroits où il peut trouver du pâturage. Dans le mois de février, quand un soleil brûlant dévore toutes les plantes du désert, le Maure abat ses tentes et s’avance vers le sud près des contrées qu’habitent les Nègres, et il y demeure jusqu’à ce que les pluies de juillet commencent. Alors, ayant reçu des Nègres du grain et d’autres objets de nécessité, et leur ayant donné du sel en échange, il retourne au nord dans le désert, où il se tient jusqu’à ce que les pluies aient cessé et que le lieu où il campe redevienne inhabitable.
Le besoin de mener une vie errante non seulement accoutume les Maures à la fatigue et aux privations, mais il resserre les liens de leurs petites sociétés et leur inspire pour les étrangers une aversion presque insurmontable. N’ayant point de rapports avec les nations civilisées, et se croyant bien au-dessus des Nègres parce qu’ils possèdent, quoiqu’à un petit degré, la connaissance des lettres, ils sont à la fois les plus vains, les plus orgueilleux et peut-être les plus bigots, les plus féroces et les plus intolérants de tous les hommes. Enfin ils unissent à l’aveugle superstition du Nègre la perfidie et la sauvage cruauté de l’Arabe.
Il est probable qu’avant mon arrivée à Benowm la plupart des Maures du Ludamar n’avaient jamais vu d’homme blanc, mais tous avaient appris à sentir une extrême horreur pour le nom de chrétien et à croire qu’il n’y avait pas plus de mal à massacrer un Européen qu’un chien. Le sort déplorable du major Houghton, et les mauvais traitements que j’endurai pendant que je fus dans les mains des Maures, doivent, je crois, suffire pour engager désormais les voyageurs à éviter ce peuple inhospitalier.
Peut-être s’attendait-on à trouver ici un tableau plus étendu, plus détaillé des mœurs, des coutumes, des superstitions et des préjugés des Maures, mais on ne doit pas oublier que j’étais parmi eux dans une situation qui ne me permit pas de les observer comme je l’aurais voulu. Je pourrais pourtant ajouter ici quelques détails, mais comme ils sont également applicables aux Nègres qui habitent au midi du pays des Maures je ne les écrirai que lorsque je ferai connaître ces Nègres.